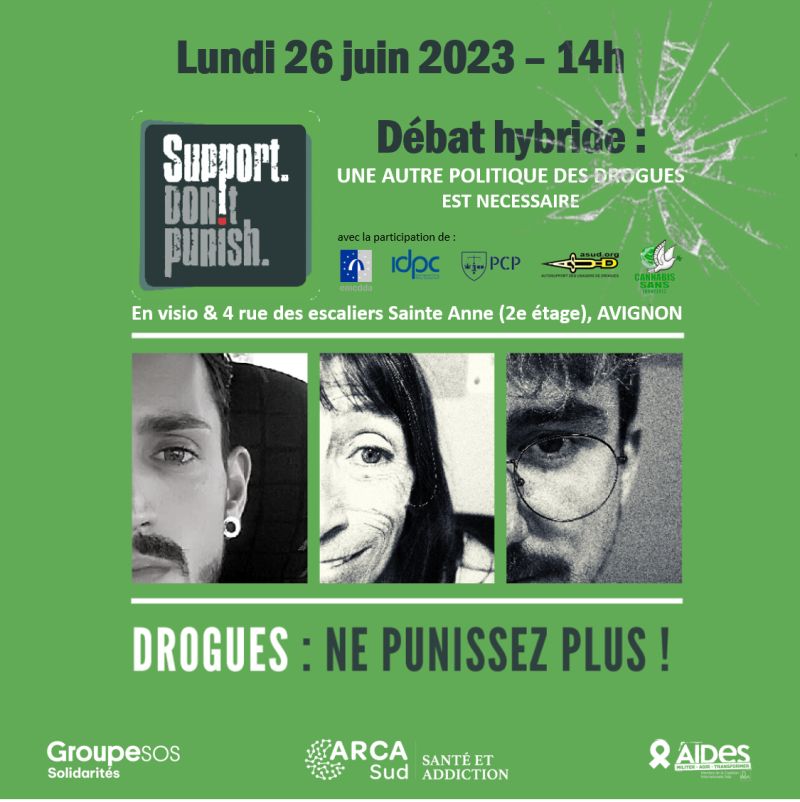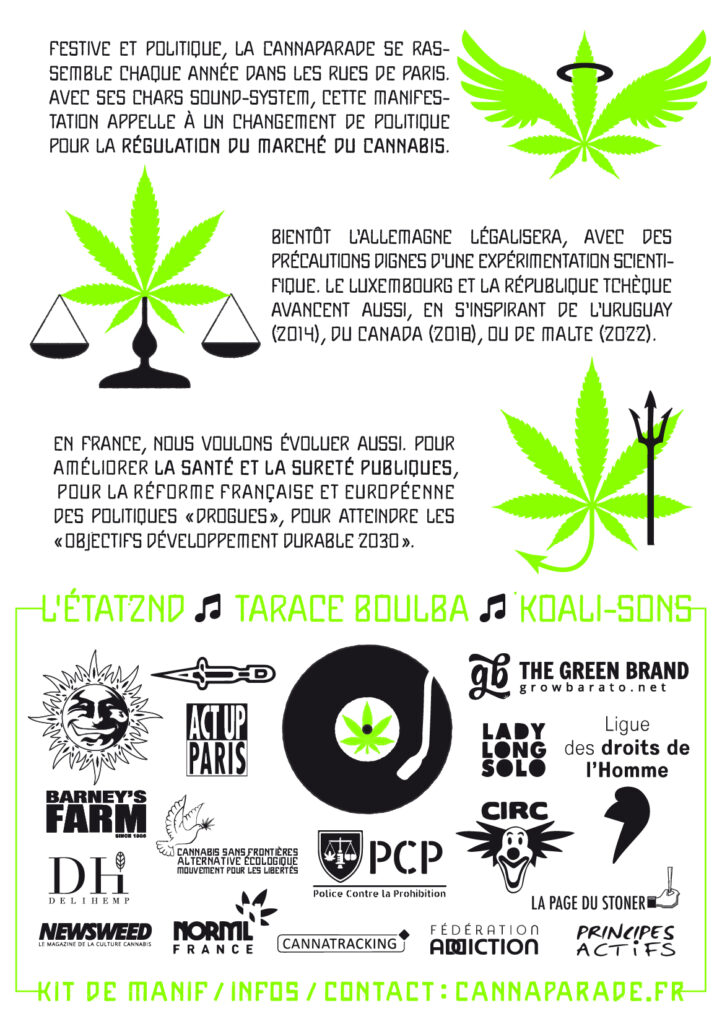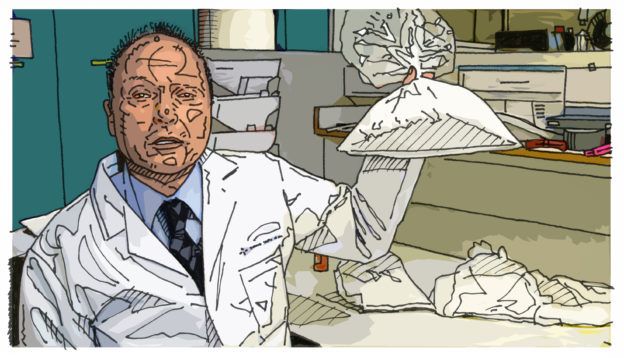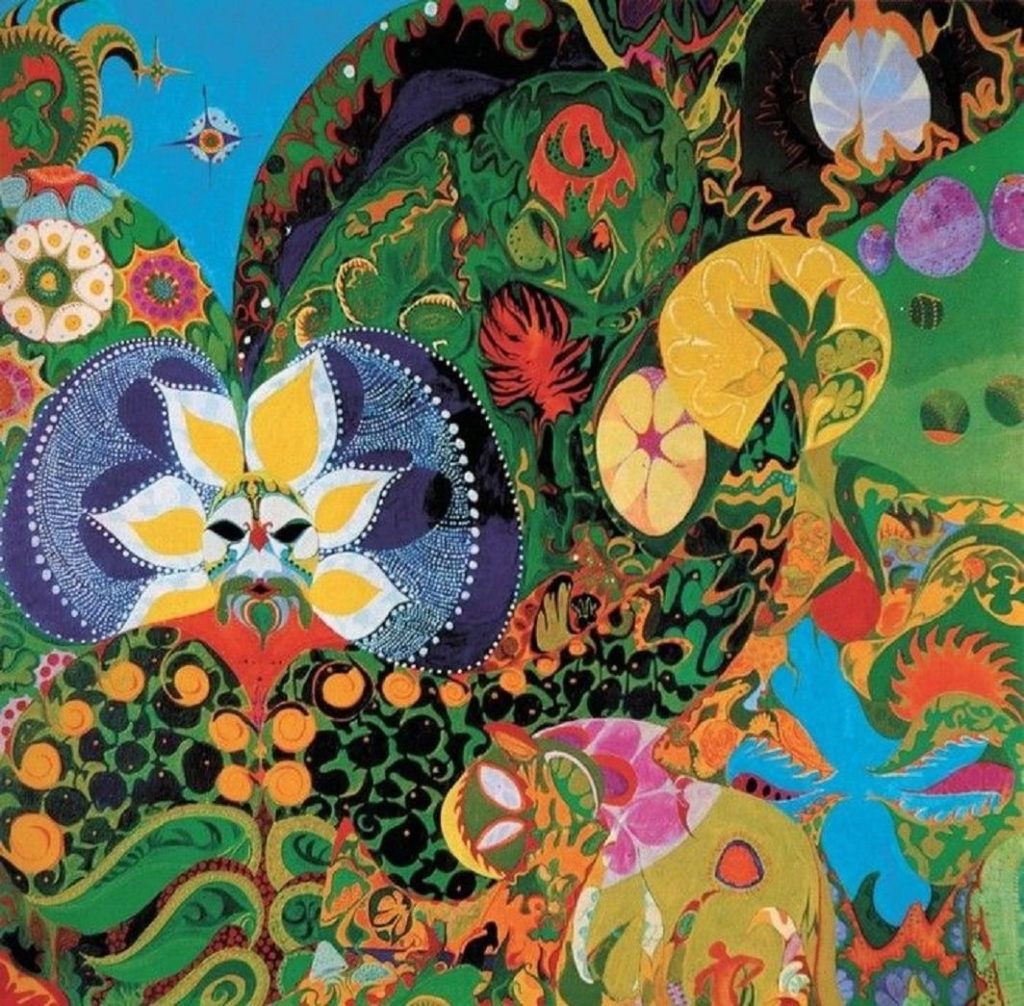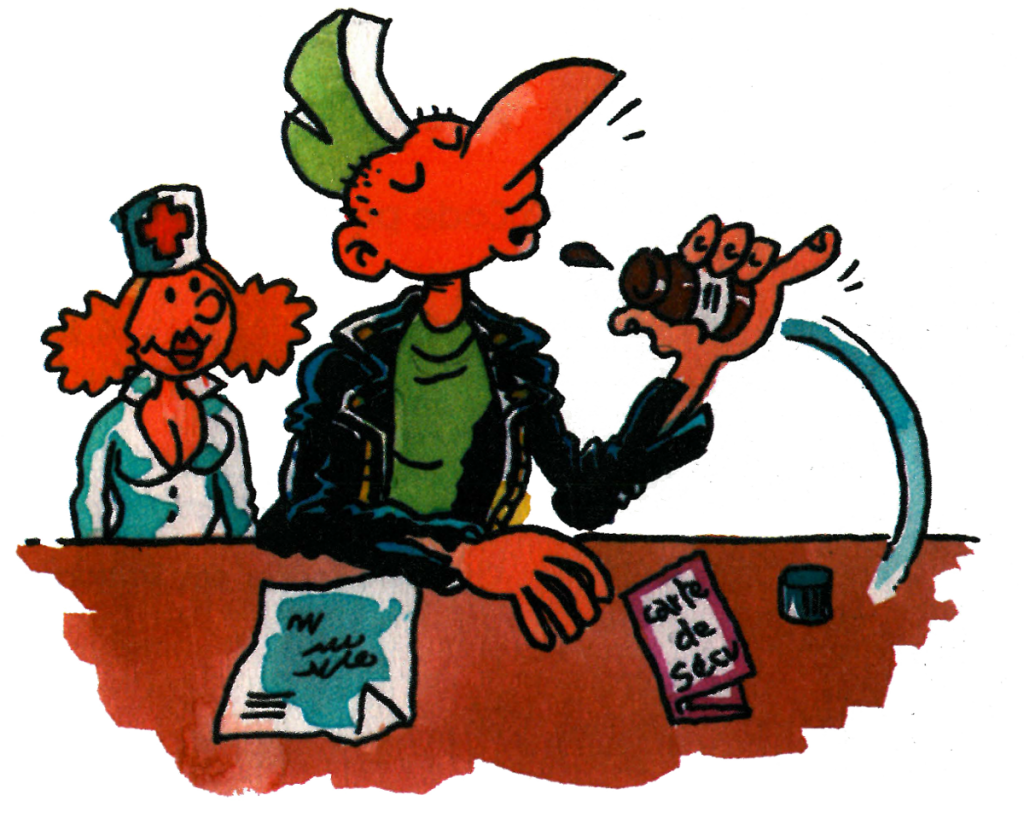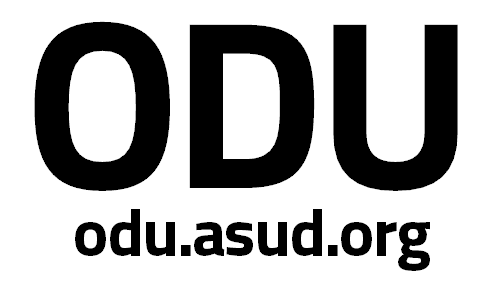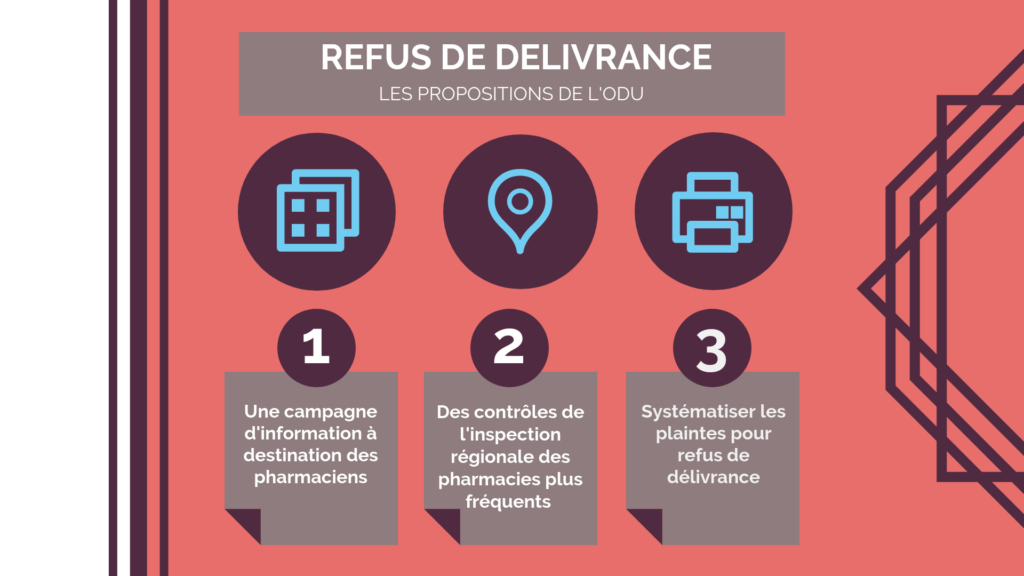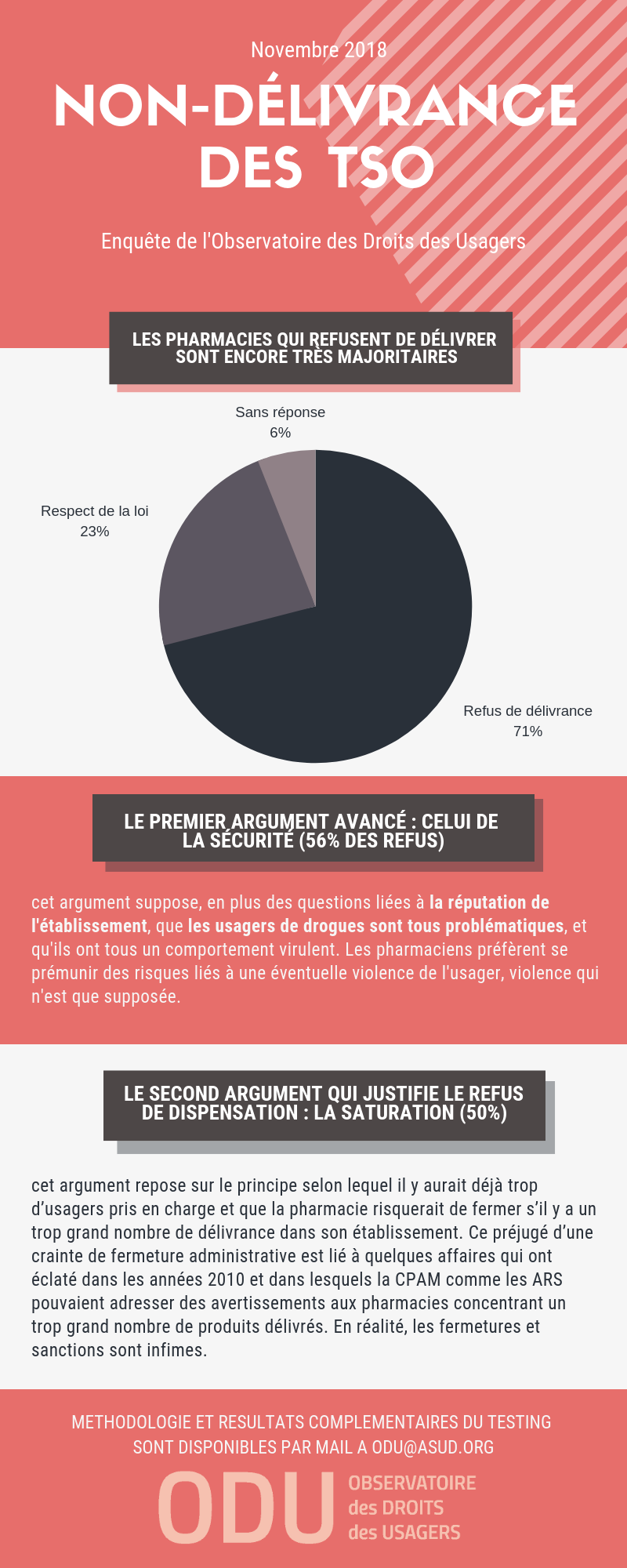EHESS,
6-7 juin 2019
Amphithéâtre
de l’EHESS, 105 bd. Raspail, 75006 Paris
Colloque
organisé par Anne Coppel, Alessandro Stella et le Groupe Genre du
CRH
La consommation de drogues n’échappe pas aux constructions sociales et culturelles genrées. Si, chez les jeunes occidentaux d’aujourd’hui, la consommation d’alcool s’est largement répandue chez les femmes, y compris dans les espaces publics, ce phénomène est tout-à-fait récent, car pour les générations précédentes d’Européens et d’Américains les femmes qui buvaient dans les cabarets, les tavernes et les bars, étaient stigmatisées et couvertes de toute sorte d’infamie. À l’instar de l’alcool chez les occidentaux, toutes les autres drogues psychotropes semblent avoir été historiquement des consommations majoritairement masculines. Que ce soit l’opium dans les sociétés indiennes, iraniennes, chinoises, la coca chez les peuples des Andes, ou encore le khat au Yémen et dans la Corne d’Afrique. Faut-il croire que les hommes ont éloigné les femmes de l’accès aux « plantes des dieux » ? Ou alors que les femmes ont pris elles-mêmes des distances avec des substances modifiant les comportements personnels et les relations sociales ? Pourtant, un peu partout, les curanderas, les sages-femmes et d’autres femmes moins sages, se sont appropriées des plantes soignantes. L’histoire au présent des usages de drogues semblent rompre bien de traditions, sous l’effet de la diffusion rapide et mondiale des substances et des changements des comportements personnels. L’hypothèse que nous formulons est que ce n’est pas le type de psychotrope en soi, ni les effets attendus qui produisent une consommation différente selon le genre, mais le cadre culturel, relationnel, dans lequel vivent des hommes et des femmes qui en influence l’usage. Entre psychotropes soignants, ludiques, performatifs, les drogues se mélangent aux construction de soi et à l’environnement collectif.
Jeudi
6 juin 2019, matin : Différence de genre, mélange de
drogues
Anne
Coppel, sociologue, Présidente honoraire d’ASUD = Introduction =
« Drogues et Genre »
Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, EHESS = « Etats psychotropes et différence des sexes : l’ivresse est-elle sexuée et/ou sexuelle ? »
Cristina
Diaz-Gomez, sociologue OFDT = « Usage de drogues chez la
population féminine en France, recours aux soins et situation
épidémiologique : quelles spécificités ? »
Onata
Chaka Coulibaly, Psychologue, Université Félix Houphouët Boigny
d’Abidjan = « Genre et usages de drogues en Côte
d’Ivoire »
Florent
Schmitt, sociologue, Université de Paris XI, et Maïa Neff,
sociologue, Université de Laval (Quebec) = « Femmes enceintes,
drogues et traitement institutionnel »
Jeudi
6 juin 2019, après-midi : La morphinée, le mauvais
genre
Emmanuelle
Retaillaud-Bajac, historienne, Université de Tours = « Les
drogues au féminin en France, du XIXe siècle aux années 1930 :
ambiguïté et contradictions d’une représentation genrée »
Zoé
Dubus, historienne, Université d’Aix-Marseille =
« La morphinée : construction et représentation
d’un mythe dans le discours médical »
Xavier
Paulès, historien, EHESS = « Les femmes et l’opium à Canton
sous la République (1912-1949) »
Malika
Tagounit, intervenante centres de soins = « Héroïne et genre
en France dans les années 1970 »
Vendredi
7 juin 2019, matin : Genre et drogues entre usages
traditionnels et modernes
Maziyar
Ghiabi, historien, Oxford University = « Le genre de
l’intoxication. Les femmes iraniennes et l’expérience des
drogues »
Maggy
Granbundzija, anthropologue = « La révolution (du genre) par
le qat ? »
Kenza
Afsahi, sociologue, Université de Bordeaux = « La consommation
de cannabis au Maghreb : une sociabilité masculine ? »
Vendredi
7 juin, après-midi : Sexe et drogues
Virginie
Despentes, écrivaine = « Sexe, drogues et rock and roll »
(sous réserve)
Laurent
Gaissad, sociologue, Ecole d’architecture de Paris = « Où
sont les hommes ? Masculinités gays à l’épreuve du
chemsex »
Thierry
Schaffauser, travailleur du sexe, STRASS = « Drogues et
travail sexuel »
Gianfranco Rebucini, anthropologue, EHESS = « Drogues et politiques queer »
Contact :
Alessandro.stella@ehess.fr
vuckovic@ehess.fr
Anne Coppel : « Introduction »
Résumé:
Si la consommation de drogues est soumise à l’emprise des normes
de genre, elle a aussi accompagné la mise à l’épreuve de ces
normes. A plusieurs reprises au cours du XXe siècle et
jusqu’à aujourd’hui, l’hétérosexualité construite comme
norme naturelle a été interrogée par les mouvements de libération
des femmes, et, en leur sein ou à leur marge, par les voix
dissidentes théorisées par la problématique queer. Parce qu’elles
modifient les états de conscience, les drogues psychotropes ont pu
favoriser l’expérimentation de nouvelles construction de soi, avec
d’autres expériences subjectives corporelles, d’autres relations
aux autres et contribuer ainsi à la construction de nouvelles
identité de genre.
CV:
Sociologue, Anne Coppel est spécialiste de la politique des drogues,
de la lutte contre le sida et de la réduction des risques liée à
l’usage de drogues. Entre recherche et action, elle a mené des
recherches sur les consommations de drogues, sur les pratiques à
risques face au sida, la sexualité, le genre, la prostitution,
l’auto-support des usagers de drogues, recherches qui ont débouché
sur des projets expérimentaux de réduction des risques (BUS des
Femmes, programmes de méthadone). Militante associative, elle a
animé le débat public sur la politique de réduction des risques
comme présidente du collectif Limiter la casse (1993-1997), puis
avec la création de l’AFR, l’association française de réduction
des risques (1998-2012). Prix international de la réduction des
risques, Rolleston Award 1996. Publications : Le Dragon
Domestique, deux siècles de relations étranges entre les
drogues et l’Occident, en coll. avec Christian Bachmann, Albin
Michel, 1989, 564 p. ; Peut-on civiliser les drogues ?
De la guerre à la drogue à la réduction des risques, La
Découverte, 2002, 380 p. ; Sortir de l’impasse,
expérimenter des alternatives à la prohibition des drogues,
avec Olivier Doubre, La Découvertes, 2012, 287p.
Véronique Nahoum-Grappe : « L’ivresse est-elle sexuelle ? l’ivresse est-elle sexuée ?
Résumé :
Ces deux questions, posées du point de vue de l’ethnologie, sont
différentes. Au regard de ce psychotrope licite qu’est l’alcool, à
l’échelle individuelle, l’invasion du système neurocognitif par
l’éthanol est extrêmement hétérogène : à dose égale,
l’expressivité de l’ivresse est spécifique non seulement entre les
sujets des deux ou cinq sexes, mais aussi au sein d’une même
trajectoire de vie lors des diverses « cuites » éventuelles.
Différentes dans leur « occasion », leur sémiologie propre
pour le buveur (toujours sobre dans son choix de « boire »
à ce moment-là), et selon bien sur l’inscription culturelle,
historique, sociale conjoncturelle de ce choix, et la scénographie de
son présent, les scènes d’ivresse sont à chaque fois particulières
pour l’ethnologue. Du point de vue des ivresses en tant
qu’expériences psychotropes souvent jouissives, ne sont peut-être
pas plus différentes en fonction des sexes qu’entre elles. Mais
le fait que les sciences cliniques (chimie médecine
psychiatrie) s’accordent pour dénoncer une plus grande
toxicité en terme de santé physique et psychique pour les femmes
masque l’ivresse en tant que scène où ce qui se passe d’enivrant
n’est pas plus susceptible d’être défini comme « sexué »
que l’état de sobriété consciente. Pourtant la différence
des sexes est une des constantes de l’épidémiologie des
consommations d ‘alcool, plus importante en France que les
différences de classes sociales … L’intervention ici voudrai
penser cette discordance.
CV : Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, chercheure associée au IIAC EHESS. http://www.iiac.cnrs.fr/article42.html
Cristina
Diaz Gomez : « Usage de drogues chez la population féminine en
France, recours aux soins et situation épidémiologique : quelles
spécificités ? »
Résumé :
Cette présentation aborde la question des spécificités des femmes
sous l’angle de l’épidémiologie descriptive des drogues. Elle
présente les évolutions récentes de l’usage des drogues en
population générale, observées en France parmi les jeunes et les
adultes, en explorant l’influence du genre. En analysant les
situations contrastées, cette intervention se propose également de
caractériser les publics féminins fréquentant les dispositifs de
soutien aux usagers(ères) de drogues à partir des enquêtes
d’observation récentes réalisées à l’Observatoire français
des drogues et des toxicomanies (usages, pratiques à risque,
comorbidités…). Enfin, la question du recours aux services de
prévention, d’accompagnement et de soins des femmes usagères sera
analysée ainsi que celle de l’adaptation de l’offre aux
spécificités progressivement identifiées par les institutions et
les professionnels.
CV :
Cristina Diaz Gomez est économiste-épidémiologiste. Diplômée en
méthodes de recherche clinique par l’ISPED, Cristina Díaz Gómez
détient également un DEA en économie de la santé. Elle a démarré
sa carrière à l’international en tant que membre du programme
MEANS lancé par la Commission européenne en 1999 qui a permis
d’améliorer et de promouvoir l’évaluation des politiques
publiques en Europe. A l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT), elle est responsable du pôle Évaluation des
politiques publiques. À ce titre, elle coordonne et supervise les
travaux d’évaluation des dispositifs existants dans le champ des
addictions. Elle contribue également à l’évaluation des plans
gouvernementaux. Elle est spécialisée dans la recherche
interventionnelle, examinant l’efficacité des réponses élaborées
pour prévenir les consommations, réduire les risques et accompagner
les usagers en difficultés.
Maïa
Neff et Florent Schmitt : « Le traitement
institutionnel des femmes enceintes en établissements de soins et de
réduction des risques «
Résumé
: Comment les femmes enceintes sont-elles prises en charge dans
les établissements médico-sociaux de réduction des risques (RdR) –
CSAPA et CAARUD ? Cette étude de cas montre que les pratiques et les
discours des professionnel·le·s intervenants dans ces structures
opèrent un réajustement genrée des principes de RdR lors des
périodes de grossesse des femmes usagères de drogues. La
temporalité de l’accompagnement imposée par la grossesse (opposé à
l’adaptation au « rythme de l’usage.r.e »), le type de normes
mobilisées et le déploiement de formes de coercition (opposé à la
« libre adhésion » de l’usage.r.e) constituent les
différents indicateurs de ces réajustements. La grossesse des
femmes usagères de drogues apparait ainsi comme une circonstance
favorisant un traitement institutionnel spécifique qui peut venir
renforcer la division sexuée des rôles.
CV :
Maïa Neff : Doctorante en sociologie à l’Université Laval de
Québec et à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, ma recherche porte
sur le genre des carrières institutionnelles en addiction à Paris
et Montréal. A ce titre, ma thèse s’axe plus particulièrement sur
le traitement institutionnel des usages de drogues au féminin, au
sein de structures médico-sociales en addictologie.
Florent
Schmitt est doctorant en sociologie à Paris XI et rattaché au
Cermes3. Son travail de thèse porte sur le rapport des usage.r.es de
drogues aux CAARUD et l’implication du « rester usager.e.s »
à long terme sur la mise en œuvre des missions de santé publique
et de réinsertion sociale de ces institutions.
Emmanuelle
Retaillaud : « Femmes et usages de drogues, entre
interdits, exclusions et transgressions (France, 1800-1939) »
Résumé :
Lorsque l’usage des produits stupéfiants commence à se répandre
en France au cours du XIXe siècle, le regard social
dénonce volontiers la femme initiatrice et corruptrice, assimilée à
l’Eve de la tradition biblique, alors même que les statistiques
disponibles suggèrent une pratique à dominante masculine, découlant
de rapports sociaux de sexe structurellement inégalitaires. A
contrario, la drogue au féminin apparaît souvent comme un facteur
de vulnérabilité – dans le cas, notamment de la prostitution ou des
femmes au foyer. En faisant la synthèse d’un siècle et demi
d’histoire des drogues, cette communication souhaiterait analyser
l’évolution d’un système de représentations dont la dimension
genrée apparaît centrale, en montrant que le déplacement des
frontières et des motivations de l’interdit reconduit une
hiérarchisation du masculin et du féminin qui constitue la femme à
la fois, ou successivement, en exclue de la sacralité des paradis
artificiels mais aussi en agent de transgression à surveiller et à
dénoncer – un double bind qui reconduit l’ambivalence des
statuts féminins dans l’ordre de la sexualité, contrôlés parce
que redoutés.
CV :
Emmanuelle Retaillaud est MCF-HDR en histoire contemporaine à
l’université François-Rabelais de Tours (CeTHIS/HIVIS). A
notamment publié : Les drogues, une passion maudite,
« Découvertes » Gallimard, 2003 ; Les paradis
perdus, drogues et usages de drogues dans la France de
l’entre-deux-guerres, Rennes, PUR, 2009 ; Stupéfiant,
l’imaginaire des drogues de l’opium au LSD, Textuel, 2017.
Zoë
Dubus : « La Morphinée : construction et représentation
d’un mythe dans le discours médical »
Résumé :
La question de la perception genrée de la consommation de morphine à
la fin du XIXe siècle a lourdement pesé dans l’élaboration du
discours médical, puis populaire, érigeant « la drogue » en
problème social dans la société contemporaine. La morphine entre
définitivement dans la pratique quotidienne des médecins au début
des années 1860 grâce à l’invention de la seringue. Dans un
contexte où ceux-ci n’ont guère d’efficacité thérapeutique,
le soulagement de la douleur assure au praticien une clientèle
fidèle et admirative. Après une décennie d’emploi sous forme
injectée, les médecins constatent qu’ils sont à l’origine
d’une nouvelle pathologie liée à une prescription médicale et
qu’ils vont nommer « morphinomanie » aux alentours de 1875. Il
s’agit alors pour les médecins de se dédouaner de la
responsabilité de cette pathologie : si les statistiques produites à
l’époque démontrent inlassablement que l’origine de la
morphinomanie est due à la prescription trop désinvolte d’un
homme de l’art, ceux-ci élaborent un archétype du morphinomane
sous les traits d’une femme à la sexualité « perverse », qui
trouveraient dans la morphine un plaisir nouveau et morbide. Cette
condamnation de la morphine à travers ses supposées consommatrices,
que l’on nomme désormais les « Morphinées », se retrouve dans
la presse, la littérature et les arts de l’époque, ce qui
accélère le processus de diabolisation de la substance.
CV :
Zoë Dubus est doctorante en histoire à l’Université
d’Aix-Marseille en France. Sa recherche traite des transformations
des pratiques médicales ainsi que des politiques de santé en lien
avec l’utilisation de psychotropes en France, du XIXe siècle à nos
jours. Elle s’attache à comprendre les relations qu’entretiennent
la médecine et les médecins avec les produits modifiant la
conscience et la sensibilité, conçus alternativement comme des
médicaments innovants ou comme des toxiques. Ce travail vise enfin à
replacer ces mouvements à la fois dans la question de l’expertise
médicale et de ses enjeux socioprofessionnels, et dans le contexte
plus large des rapports que la société entretient avec les
psychotropes et donc avec le plaisir, la folie, la douleur et la
mort.
Xavier
Paulès : « Les femmes et l’opium à Canton sous la
République (1912-1949) »
Résumé
: Concernant le rapport entre femmes et opium, dans les années 1930,
l’attention de la société cantonaise se porte beaucoup moins sur
les consommatrices, même si ces dernières sont soumises à une
réprobation toute particulière, que sur les yanhua (« fleurs
de la fumée »). Ces jeunes et jolies femmes, d’extraction
modeste, sont employées dans les fumeries afin de préparer les
pipes pour les clients. Cette
fixation sur les yanhua découle du fait qu’elles
cristallisent des craintes liées au maintien de l’ordre et, plus
encore, de la hiérarchie établis. En effet, les séductions
conjuguées de la drogue et de l’attrait physique de ces femmes
apparaissent susceptibles de favoriser une mobilité sociale de
mauvais aloi, qu’elle soit descendante (ruine du fumeur aisé
causée par une consommation inconsidérée d’opium), ou ascendante
(lorsqu’une yanhua parvient à séduire et épouser un riche
client).
CV :
Xavier Paulès est historien, maître de conférences à l’EHESS
depuis 2010, ancien directeur du Centre d’études sur la Chine
moderne et contemporaine (2015-2018). Il est notamment l’auteur de
deux livres : Histoire d’une drogue en sursis. L’opium à Canton,
1906–1936 (éditions de l’EHESS, 2010) et L’opium, Une
passion chinoise, (Payot ,2011).Il va publier en
2019 une synthèse sur la période républicaine : La République
de Chine, 1912-1949 (Belles Lettres) et prépare également un
livre sur l’histoire d’un jeu de hasard chinois appelé fantan.
Malika
Tagounit : « Héroïne et genre en France dans les
années 1970 »
Résumé :
Cette présentation concerne les consommations d’héroïne devenues
visibles à la fin des années 60. Pour mieux appréhender le
comportement d’usage à travers une lecture genrée, il m’a
semblé pertinent d’ajouter, dans un deuxième temps, ce que vivent
les usagères de crack, drogue qui a émergé à la fin des années
80. Des observations ethnographiques issues de ma pratique
professionnelle ou de ma participation à plusieurs recherches
montrent que les usagères de drogues sont confrontées à des
rapports sociaux, relationnels et culturels liés à leur genre. Leur
statut, leur rôle, leur place dépend étroitement de leur
singularité et des hommes qui les entourent. Le poids de la
dépendance et la nécessité du financement de l’accès au
produit, qu’il s’agisse de délinquance, de deal, de
prostitution, régentent eux-aussi le comportement d’usage. Dans
cet environnement collectif d’hommes et de femmes, où se pose
continuellement la question du « qui
fait quoi
?» pour permettre l’usage, la construction de soi des usagères
d’héroïne fait apparaître des possibilités de catégorisation.
Ces catégories d’usagères, seule ou en couple, actrices ou pas
dans l’accès au produit, ne sont pas figées dans le temps.
L’usagère qui assume seule son comportement d’usage peut devoir
faire face à la violence des hommes de son milieu, en plus des
risques inhérents à son activité. Pour se sentir « protégée
»,
elle devra faire des alliances. Cette violence masculine sera plus
fréquente si l’usagère, jugée se comporter « comme
un homme », se
lance dans une activité de deal. A l’image d’une Guerrière,
elle
devra redoubler de stratégies de protection et passer elle aussi par
des alliances. Les femmes sont minoritaires dans le milieu des
drogues. Elles peuvent même vouloir rester invisibles par peur des
réactions de la société à leur encontre, notamment ce qui a trait
à la garde de leurs enfants. Les usagères se sentent stigmatisées
par la société, plus que les hommes, car elles ne répondent pas
aux représentations sociales et culturelles de la femme : mère,
épouse. Plus encore, quand elles recourent au travail sexuel. Dans
les quartiers Nord de Paris, les usagères de crack gravitent dans un
milieu où les hommes, dealers et usagers semblent tenir les premiers
rôles. Le travail sexuel auquel elles se livrent constitue pourtant
un moteur économique à ce système. Les modalités d’usage du
crack et le mode de vie des consommateurs très précarisés renforce
le rôle essentiel des usagères. Le travail sexuel permet la survie
du groupe élargi, à l’image d’une tribu, en termes d’achat de
crack et de besoins primaires.
Pour
autant, il ne s’agit pas d’un système matriarcal. Les usagères
de crack, à travers leur double identité prostitution/drogue, leur
dégradation physique, ont perdu leur image de femme, même aux yeux
des hommes du groupe « ce
ne sont plus des femmes ».
Des actes de violence, de racket, de pressions psychologiques
s’exercent sur elles. Pour analyser l’ambivalence de leur statut,
à la fois «
dominantes par l’argent et victimes », il
importe de prendre en compte les conditions de vie très misérables
qui influent sur les relations dans le groupe élargi, les rapports
sociaux et culturels liés au genre car les minorités ethniques
(Dom/Tom, Afrique) sont très représentées dans ce milieu.
CV :
Dans lesassociations
Charonne, Aurore, Médecins du Monde, Arapej,
j’ai travaillécomme
intervenante socio-sanitaireauprès
d’usagers de drogues (opiacés, crack…), de jeunes en errance, de
sortants de prison, de travailleurs sexuels. Comme Chef de Projet,
j’ai misen
place des projets de Réduction des Risques innovants : des accueils
bas seuil « Boutique
18 », « Beaurepaire » et
«
Itinérances » ;
le premier lieu d’accueil pour usagères de drogues en réponse à
leurs besoins ; spécifiques « Espace
Femmes » ;
la première Antenne Mobile auprès d’usagers de crack qui
intervient sur les scènes ouvertes et dans les squats. J’ai été
Présidente de Limiter La Casse et Membre du Bureau AFR (Association
Française de Réduction des Risques). J’ai participé à plusieurs
recherches dont : Hépatite C et usagers de crack (Rodolphe
Ingold / IREP) ;
Usagers de crack (Rodolphe
Ingold / IREP) ;
Travail sexuel et usagers de crack (Rodolphe
Ingold / IREP) ;
Nouveaux usagers d’héroïne (Groupe
de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale / Catherine
Reynaud-Maurupt) ;Usagers
de kétamine (Groupe
de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale / Catherine
Reynaud-Maurupt) ;
Usagers de Rohypnol (Groupe
de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale / Catherine
Reynaud-Maurupt) ;
Enquêtrice à l’Ofdt (dispositif Trend).
Onata
Chaka Coulibaly : « Genre et usages de drogues en Côte
d’Ivoire »
Résumé :
Présentation de la problématique de l’usage de drogues en Côte
d’ivoire, les évolutions sur la question du genre dans nos
sociétés africaines, notamment les mutations en termes de culture
et des modifications des comportements sociaux. La représentativité
des femmes dans cette population d’usagers de drogues dont nous
avons suivis durant l’étude. Les résultats en termes de niveau de
scolarisation, le statut matrimonial et l’âge moyen de cette
population d’usagers de drogues selon le genre. Les différences
qui pourraient exister en termes de types de drogues consommées que
d’effets recherchés par la consommation de ces drogues et enfin la
discussion des résultats par rapport aux travaux antérieurs et les
recommandations.
CV :
Onata Chaka Coulibaly, titulaire d’un Diplôme d’études
Approfondies de Psychologie, Doctorant au Laboratoire de Psychologie
Génétique Différentielle de l’Université Félix Houphouët
Boigny d’Abidjan (Côte d’ivoire). Psychologue consultant dans la
prise en charge des usagers de drogues, à la Croix Bleue Côte
d’Ivoire, de Septembre 2014 à Septembre 2018.
Maggy
Grabundzija : « La révolution (du genre) par le qat
? »
Résumé :
Au Yémen, mâcher la feuille de qat est une pratique
répandue, auxquels hommes et femmes s’adonnent parfois
quotidiennement. Une abondante littérature s’est attelée à
analyser la portée sociale, politique, identitaire ainsi que les
impacts économiques, médicaux et environnementaux d’une telle
consommation qui s’étend depuis ces quarante dernières années
dans toutes les régions du pays ainsi qu’au sein de toutes les
classes sociales. Si les femmes sont évoquées dans ces écrits, il
n’en reste pas moins qu’une grille d’analyse genrée qui met en
perspective la pratique du qat dans le cadre des dynamiques
des rapports hommes et femmes reste encore à être définie. Notre
intervention tentera de formuler des pistes de réflexions pour
décrypter la pratique du qat au regard des rôles et
fonctions des hommes et des femmes dans diverses régions. Il s’agira
également de s’interroger sur le mouvement révolutionnaire de
2011 et notamment de savoir si les nouveaux espaces de luttes
inconnus dans l’histoire du Yémen ont permis une nouvelle
dynamique de genres se reflétant dans la pratique du qat.
CV :
Maggy Grabundzija est une consultante et chercheure indépendante,
docteure en anthropologie sur les questions de genres au Yémen, pays
dans lequel elle a vécu pendant quinze années. Elle a notamment
publié un livre aux éditions L’Harmattan (2015), Yémen
morceaux choisis d’une révolution.
Kenza
Afsahi : « Maisons de maajoun »
: Travail invisible des femmes dans le marché du cannabis (Maroc) »
Résumé :
Traditionnellement, au Maroc, le maajoun (préparation
sucrée à base de cannabis) était
un produit partagé ou offert, non commercialisé. Fait complètement
nouveau, de plus en plus de femmes sont arrêtées ces dernières
années dans les villes pour leur implication dans la fabrication et
la vente de maajoun. Par
ailleurs, les produits ont pris de nouvelles formes et ne sont plus
conditionnés de la même façon. Quelles
places occupent les femmes dans cette nouvelle activité ? Que
révèle cette activité sur le marché du cannabis ?
CV :
Kenza Afsahi est Maîtresse de Conférences en sociologie à
l’Université de Bordeaux et chercheuse au Centre
Emile Durkheim (CNRS). Elle est co-responsable de
l’axe de recherche Sociologie (S) de l’International au Centre
Emile Durkheim et membre du comité de rédaction de la Revue
Française des Méthodes Visuelles. Elle est également associée
au Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les
Institutions Pénales (CNRS). A l’Université de Bordeaux,
elle enseigne la sociologie de la déviance, la sociologie du marché
du cannabis, la sociologie visuelle, les questions de l’implication
des femmes dans le marché de la drogue et de criminalité
environnementale. Son parcours de recherche se focalise sur la
manière dont les acteurs déviants construisent des normes et des
régulations dans le monde de la drogue. Après avoir travaillé sur
la production, elle étudie aujourd’hui le marché du cannabis dans
son ensemble, en conjuguant l’offre et la demande. Elle s’intéresse
particulièrement à la construction socio-économique des marchés,
à la circulation des savoirs, aux questions du travail invisible et
domestique, en mettant l’accent sur les femmes et les
intermédiaires, à l’environnement et aux ressources naturelles.
Elle a par ailleurs initié de nouvelles comparaisons internationales
Sud/ Sud avec le Liban et le Brésil.
Olivia
Clavel : « Sexe, drogues, images »
Résumé
et CV : est une plasticienne et autrice de bande dessinée
française. Née en 1955 à Paris, elle fait ses études à
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts à Paris à
partir de 1972. En 1975, elle participe au collectif
Bazooka associé au mouvement punk sous le
pseudonyme Electric Clito. Clavel se lance en particulier
dans la bande dessinée, où elle change les conventions du groupe et
de la bande dessinée en général. En 1976, elle commence à publier
les aventures de « Joe Télé », son alter ego fictif avec
une tête en forme d’écran, Pendant plusieurs années elle
signe ses œuvres sous le nom d’Olivia « Télé » Clavel.
Puis elle s’éloigne de la bande dessinée pour se pencher plus
vers la peinture. En 2002, elle participe au projet Un
Regard moderne, repris du blog de Loulou Picasso
(Libération). Elle participe aussi à quelques projets
vidéo : Traitement de substitution n°4 et L’Œil
du Cyclone. En juin 2013, elle expose une collection intitulée
« Vers Jung » à la galerie Jean-Marc Thévenet de
Paris. En 2019, elle fait partie de l’équipe des
dessinatrices du nouveau mensuel féministe satirique Siné
Madame, dès son lancement.
Laurent
Gaissad et Tim Madesclaire : « Où sont les hommes ?
Masculinités gays à l’épreuve du chemsex »
Résumé :
Véritable pornotopie (Preciado, 2011), l’usage de drogues chez les
gays s’est peu à peu dissocié de leurs mondes festifs pour se
replier sur leur sexualité collective à domicile avec le
développement d’internet et, plus dernièrement, des applications
de rencontre par géolocalisation en ligne. En miroir de la crise du
sida, le chemsex (pour chemical sex) a été analysé
au prisme des risques pour la santé plutôt qu’en regard des
performances corporelles masculines optimisées par les multiples
substances consommées (Fournier, 2010) : multi partenariat,
endurance, lâcher-prise, surtout pour ce qui concerne la sexualité
anale. On reviendra ici sur le rôle-clef que les drogues ont joué
dans les normes de genre au cœur des sexualités gays
contemporaines, affranchissant le plaisir tout en le conformant aux
attendus virils des rôles sexuels. Références : Preciado B.
Paul, Pornotopie. Playboy et l’invention de la sexualité
multimédia, Paris, Flammarion, « Climats », 2011 ;
Fournier Sandrine, « Usages de psychoactifs, rôles sexuels et
genre en contexte festif gay (Paris/Toulouse, 2007) », Clio.
Histoire, femmes et sociétés, Vol. 31 N° 1, 2010, p. 169-184.
CV :
Laurent Gaissad, socio-anthropologue à l’EVCAU (Environnements
Virtuels, Cultures Architecturales et Urbaines) à l’ENSA Paris
Val-de-Seine. Il a publié de nombreux articles sur l’espace public
et la sexualité au temps du sida. Tim Madesclaire, chercheur
indépendant, Paris. Éditeur la revue Monstre. Consultant
pour les programmes Santé sexuelle des HSH (Hommes ayant des
rapports Sexuels avec des Hommes) de Santé Publique France
(Prends-moi, Sexosafe). Tous deux ont coréalisé
l’enquête APACHES (Attentes et Parcours liés au CHEmSex) pour
l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies en 2018.
Thierry
Schaffauser : « Drogues et travail sexuel »
Résumé :
L’usage de drogues est souvent associé au travail du sexe (appelé
« prostitution ») afin de stigmatiser l’une et l’autre
pratique. Au milieu des années 1980, l’émergence du VIH au sein de
la communauté des travailleuses du sexe, en particulier celles
usagères de drogues, a poussé les pouvoirs publics à accepter des
politiques et pratiques de réduction des risques et de santé
communautaire par & pour. Avec la généralisation des
traitements de substitution, la thématique de « l’addiction »
comme cause du travail sexuel cède du terrain dans les
représentations au profit de celle de « la traite et des
trafics » dans un contexte de migration de plus en plus
mondialisée. L’association entre l’usage de drogues et le travail
sexuel, refait surface depuis quelques années, mais cette fois à
travers la thématique du « chemsex » concernant surtout les
hommes travailleurs du sexe, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives.
Entre représentations, stigmatisations, problématisation des
parcours de vie, besoins en santé, et usages personnels des
travailleurSEs du sexe, nous essaierons d’y voir plus clair.
CV :
Thierry Schaffauser est travailleur du sexe et usager de drogues.
Ancien militant d’Act Up-Paris et cofondateur du STRASS, le Syndicat
du Travail Sexuel, il défend la syndicalisation des industries du
sexe et leur complète décriminalisation. Il est l’auteur du livre
Les Luttes des Putes aux éditions La Fabrique et auteur du
blog sur Libératio.fr « Ma Lumière Rouge« .
Gianfranco Rebucini : « Drogues et politique queer.
Le chemsex comme pratique culturelle en contexte de contrôle
capitaliste ».
Résumé :
Dans la définition médiatique et médicale, le chemsex est
l’association de drogues (chem) au sexe (sex) tenue
pour répandue spécialement chez les hommes gays. Cette définition
et juxtaposition impliquent donc la possibilité d’une définition
préalable de ce qu’est le sexe. Si le chemsex existe
c’est parce que le « sexe » existe. Nous savons déjà
ce qu’il est et qu’il est forcément sobre. Les « experts »
médicaux et communautaires s’accordent à définir le chemsex
comme une pratique associant des caractéristiques distinctives,
parmi lesquelles l’usage de produits psychotropes, des relations
sexuelles répétées, souvent avec des partenaires multiples, mais
aussi de modes de rencontre sur les applications de géolocalisation.
Dans une perspective queer et marxiste, cette intervention se
concentrera plus particulièrement sur ces caractéristiques
culturelles. Il s’agir alors d’aborder cette pratique comme une
pratique culturelle à part entière dans le contexte plus large du
contrôle biopolitique du capitalisme postfordiste touchant à la
sexualité et au sexe. D’autre part, nous verrons le chemsex
comme pratique de dévoilement et comme potentialité politique et
créative parlant peut-être de ce que le sexe est ou plutôt
de ce qu’il fait dans ce contexte capitaliste.
CV :
Gianfranco Rebucini,est
docteur en anthropologie sociale et ethnologie. Chercheur associé au
IIAC – LAIOS (EHESS-CNRS), il est spécialiste des études sur les
masculinités et sur les sexualités entre hommes et, plus récemment,
se consacre à une recherche concernant le rapport entre les
identités et les pratiques politiques queer. Parmi ses publications
: éditeur scientifique associé de Juliette
Rennes (dir.) Encyclopédie
critique du genre,
Paris, Éditions de la Découverte, 2016.