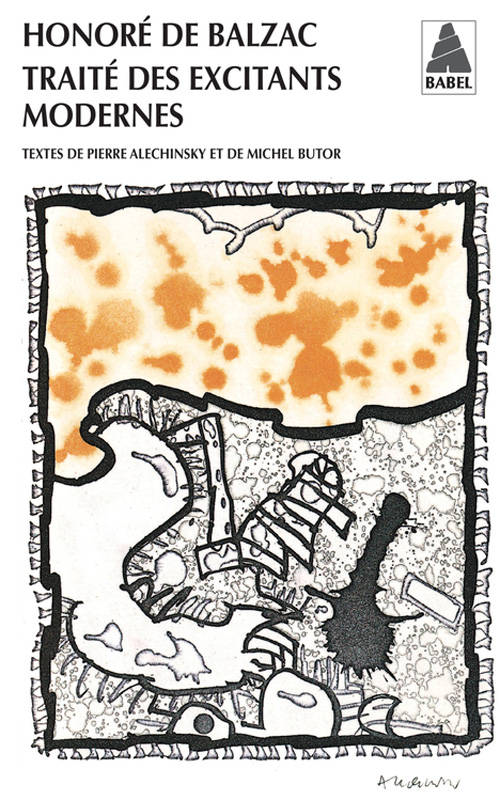Elles aspirent les budgets de recherche, servent de référence aux politiques gouvernementales, diffusent leurs résultats jusque dans les médias les plus généralistes. Les nouvelles sciences ont pris une importance considérable dans le champ des drogues. Pour le meilleur… Et pour le pire !
Télé, presse écrite, cinéma ou café du commerce, dès lors qu’il s’agit d’expliquer la consommation de drogues, les nouveaux champs d’exploration de l’Homme (bio-psychologie, génétique, et neurosciences) sont partout. Pourtant les résultats ne sont pas au rendez vous : les recherches en génétique n’ont identifié que quelques anomalies qui n’expliquent qu’un faible nombre de cas et uniquement pour les troubles psychiatriques les plus sévères9. Quant aux neurosciences elles n’ont abouti ni à la mise au point d’indicateurs biologiques pour le diagnostic des maladies psychiatriques, ni à de nouvelles classes de médicaments psychotropes10. Elles comptent par contre parmi les domaines de recherche les plus touchés par des rétractations d’articles11.
La grande illusion
En effet, de l’aveu même d’un neuro-biologiste, « on croit toujours s’approcher de la réalité et celle-ci ne cesse de reculer »12. Ajoutons à cela l’enthousiasme des chercheurs face aux potentialités de ces nouvelles sciences et l’on obtient un programme grandiose13 caractérisé par une « inflation de promesses irréalistes »14.
On assiste ainsi depuis une quinzaine d’années à la multiplication d’annonces de grandes avancées qui ne sont finalement jamais suivi d’effets… A l’exception de l’impact social de ces annonces elles mêmes ! Car la sur-médiatisation de pseudos découvertes comme le gène de l’addiction/assassin/altruisme ou les spécificités du cerveau des homosexuels/drogués/personnes violentes, diffuse une vision déterministe et essentialiste qui n’engendre pas la tolérance et laisse penser qu’un monde meilleur est à portée d’éprouvette et de bistouri.
Pourtant, neuro-biologistes et généticiens n’ont pas pour objectif de stigmatiser encore plus les populations qu’ils étudient, au contraire ! Avant de basculer vers des conceptions eugénistes qui firent le terreau du nazisme, le naturalisme dont relève la conception neurobiologique des déviances (et notamment de l’alcoolisme), fût au XIXe un courant progressiste. Cesare Lombroso lui même (le père de la phrénologie et de l’idée de criminel-né) n’était pas un précurseur du fascisme mais un socialiste, voire un homme d’extrême gauche. Comme le rappelle M. Valleur, « faire de l’addiction un phénomène naturel, l’assimiler à une intoxication du corps était un moyen de soustraire les intempérants à la stigmatisation morale et aux foudres de l’église »15.
Médiatisation et présentation des résultats
Plusieurs chercheurs ont remarqué que des termes comme « rôle », implication, sous-tendus, reposer sur, avoir une base etc reviennent sans cesse dans les conclusions des articles de neurosciences. Sans affirmer clairement de causalité, ils en suggèrent la possibilité alors que les faits observés sont le plus souvent des corrélations7. Il en va de même de l’utilisation du conditionnel qui permet de laisser entendre des choses sans prendre le risque de les affirmer. Ces petites techniques sont courantes et pas que dans les sciences « dures », les lecteurs à l’esprit critique acéré auront d’ailleurs constaté que ce texte n’en est pas exempt !
La dépendance aux médias
Mais depuis les choses ont changé. Les enquêtes de terrain aux États-Unis montrent ainsi que les personnes partageant une conception neuro-biologique des troubles psychiques (y compris les dépendances) sont de plus en plus nombreuses16, qu’elles ont une plus forte réaction de rejet vis à vis des malades et sont plus pessimistes quant aux possibilités de guérison17.
Si les chercheurs semblent regretter cette inversion, la plupart s’en lavent les mains. Ils pointent du doigt la médiatisation de leurs travaux et les déformations sensationnalistes qui en découlent, accusant les journalistes de « mettre en porte à faux les scientifiques qui se trouvent confrontés aux drôles de lièvres qu’ils ont eux même levés »18. Ils accusent aussi le système qui produit ces erreurs : le conditionnement du financement des recherches à la publication dans des journaux populaires19, le fait que les études avec des résultats positifs sont toujours plus médiatisées que les éventuels démentis qui peuvent suivre, et la simplification systématique de leur travaux par les médias. C’est un peu facile.
Arnaque à l’imagerie cérébrale
Depuis la structure des révolutions scientifiques de T. Kuhn (1970) que l’on sait que la science n’évolue pas dans le vide et qu’elle est plus encline à confirmer la vision du monde qui a cours là où elle est produite, qu’à la remettre en question. Ainsi, le sociologue P. Cohen montre que dans de nombreux travaux, les notions culturelles se rapportant à la dépendance sont utilisées comme des évidences et « confirmées » par la suite dans des descriptions neurologiques qui sont en fait « totalement tautologiques. »20. Il remarque d’ailleurs qu’il est « tout simplement impossible de diagnostiquer la dépendance par des techniques d’imagerie cérébrale. La place de la neurologie dans le domaine de la dépendance est donc purement post hoc. L’imagerie cérébrale offre une forme de fausse promesse destinée non pas à obtenir un meilleur diagnostic, mais à suggérer un fondement scientifique et médical au concept de dépendance »21.
Outch ! Entre ce genre de critiques, les attaques méthodologiques, l’aspiration des financements de recherche etc, on comprend que depuis une dizaine d’années, le dézinguage de ces nouvelles sciences soit devenu un exercice de style pour les chercheurs en sciences sociales et que même les journaux d’habitude avides de brain-porn22 relaient ces critiques.
Ne seraient les financements pharaoniques (trois milliards de dollars sur dix ans pour cartographier le cerveau humain aux Etats-Unis, un milliard sur dix ans pour le brain human project européen) de ces branches de recherche, on aurait presque l’impression de tirer sur l’ambulance. Mais ces critiques sont nécessaires car la conception biologique de l’esprit tend à supplanter toute autre grilles de compréhension. Nous avons ainsi entendu un médecin addictologue expliquer très sérieusement que les mécanismes des flashbacks (vous savez, les remontées, comme celles de Jean Paul Sartre, poursuivi par des langoustes pendant six mois après une prise de mescaline) étaient dues au fait que le LSD et/ou le cannabis se dissolvait dans les graisses du cerveau et pouvait être « relargué » lors de privations de nourriture ou d’efforts physiques intenses. Non non, posez ces baskets et restez avec nous, en réalité les remontées sont souvent liées à des stimuli extérieurs rappelant les conditions d’un bad trip antérieur, ce qui fait plutôt pencher pour une explication d’ordre psychologique.
Do you speak scientific8 ?
|
Si vous lisez :
|
Comprenez :
|
|
On sait depuis longtemps..
|
Je n’ai pas pris la peine de chercher la référence
|
|
Bien qu’il n’ait pas été possible de donner des réponses définitives à ces questions..
|
L’expérience n’a pas marché, mais j’ai pensé que je pourrais au moins en tirer une publication
|
|
Trois des échantillons ont été choisis pour une étude détaillée..
|
les résultats des autres n’avaient aucun sens et ont été ignorées
|
|
D’une grande importance théorique et pratique…
|
Intéressant pour moi
|
|
On suggère que.. ; On sait que… Il semble…
|
Je pense
|
|
On croit généralement que…
|
D’autres types le pensent aussi
|
(Tableau tiré de : G. Nigel Gilbert, Michael Mulkay Opening Pandora’s Box : A Sociological Analysis of Scientists’ Discourse Cabridge University press, 1984.)
La nicotine ? Une intox
Physiologique ou psychologique, cette opposition divise les chercheurs. Considérons un instant la polémique sur la dépendance au tabac. En 2009 une recherche israélienne23 démontre que la dépendance à la nicotine est un mythe développé « à partir d’un mélange malsain d’intérêts politiques, économiques et de considérations morales » qui a donné « un énorme élan financier à l’industrie pharmaceutique en fournissant à la fois l’explication rationnelle et le marché pour les produits de substitution ». Vous n’en croyez pas vos yeux ? Pourtant réfléchissez à ces trois choses que confirment toutes les études : les fumeurs n’aiment pas la nicotine, les substituts nicotiniques ne diminuent pas plus l’envie de fumer que des placebos et les antagonistes de la nicotine ne provoquent pas de syndrome de sevrage.
Bien que peu médiatisés, ces résultats ont forcé les scientifiques de tout bord à admettre que la nicotine n’était pas responsable de la dépendance au tabac. Mais ensuite les avis divergent. Dar et Frenk, les deux psychologues auteurs de l’étude, en concluent que la dépendance au tabac est en réalité une « routine comportementale » qui pourrait s’assimiler à une addiction sans drogues. Les neuro-scientifiques concluent que si ce n’est pas la nicotine, la cigarette contient forcément une autre substance responsable ou co-responsable de l’addiction24. Pourtant en l’état actuel des connaissances on ne peut pas trancher cette question : psychologues ou neuro-scientifiques se contentent finalement de prêcher pour leur paroisse : les positions qu’ils défendent ne reflètent que leur idéologie.
Dans quelle étagère ?
Psychologique ou physiologique… Cette opposition a t-elle encore un sens dans un monde où l’on ne croit plus en la dualité du corps et de l’âme. C’est justement la question que posent les neurosciences en essayant de comprendre comment le cerveau produit la pensée et donc comment de la matière peut avoir conscience d’elle même ?
Pour s’attaquer à ces mystères, les substances psychoactives sont un outil incontournable. En effet, elles constituent un pont qui relie la matière à la pensée : des substances matérielles, tangibles, dont l’absorption agit sur l’esprit, la conscience. Au delà des enjeux sanitaires c’est la véritable raison pour laquelle les neuro-biologistes travaillent si souvent sur les drogues. Malheureusement, devant la difficulté d’obtenir des financements pour des recherches fondamentales, leurs recherches doivent être appliquées et concerner des points d’attention de la société (par exemple le traitement de la dépendance). Le problème étant que les obligations de résultats auxquels ils sont soumis leur imposent ces effets d’annonce dont on a vu la nocivité.
Ainsi F. Gonon (neurobiologiste de renom, très critique envers sa discipline), estime que la recherche en neurosciences est bridée par des objectifs thérapeutiques à court terme. Nous ne pouvons qu’abonder dans son sens en ajoutant qu’une recherche détachée de ses applications, peut paradoxalement s’avérer très productive. De nombreuses découvertes se sont faites de façon inattendue. C’est ce que l’on appelle la sérendipité, l’art de trouver autre chose que ce que l’on cherchait et, en matière thérapeutique, on lui doit entres autres le Lithium, le Viagra, le Valium, la Péniciline, la vaccination anti variolique… Sans oublier le LSD !
Les méthodes et leurs limites
L’imagerie cérébrale
 L’idée est simple, cartographier le cerveau en mesurant ses émissions magnétiques et électriques ou encore en suivant un « traceur » préalablement injecté dans le système sanguin. Mais les critiques sont nombreuses. D’abord l’irrigation sanguine du cerveau produit un « bruit de fond » électro-magnétique qui constitue une limite irréductible à la précision de ces techniques. Ensuite le manque de rigueur des protocoles de recherche de beaucoup d’études par imagerie cérébrale a fait scandale en 2009 avec la parution d’un article initialement titré « voodoo correlations in social neurosciences »1 qui montra qu’un grand nombre d’études par imagerie cérébrale étaient faussées par un biais de « non-indépendance ». Quelques mois plus tard, un second article2 enfonce le clou : sur 134 études testées, 56% sont bel et bien fausses !
L’idée est simple, cartographier le cerveau en mesurant ses émissions magnétiques et électriques ou encore en suivant un « traceur » préalablement injecté dans le système sanguin. Mais les critiques sont nombreuses. D’abord l’irrigation sanguine du cerveau produit un « bruit de fond » électro-magnétique qui constitue une limite irréductible à la précision de ces techniques. Ensuite le manque de rigueur des protocoles de recherche de beaucoup d’études par imagerie cérébrale a fait scandale en 2009 avec la parution d’un article initialement titré « voodoo correlations in social neurosciences »1 qui montra qu’un grand nombre d’études par imagerie cérébrale étaient faussées par un biais de « non-indépendance ». Quelques mois plus tard, un second article2 enfonce le clou : sur 134 études testées, 56% sont bel et bien fausses !
Mais au delà de ces critiques, certains s’interrogent sur la capacité de l’imagerie cérébrale (qui consiste à observer des taches colorées représentant « l’activation » d’ensembles complexes de millions de neurones interagissant ensemble) à déchiffrer quoique ce soit de l’esprit humain. Pour eux3 cela revient à peu près à essayer de comprendre les dynamiques politiques de l’Île de France en regardant Paris du hublot d’un avion !
Les comparaisons de jumeaux
 Les études visant à démontrer l’hérédité de certaines déviances ne sont pas nouvelles. Mais bien que l’existence de familles de délinquants, de consommateurs de drogues, de suicidés etc soit avérée, la part d’influence des gènes et de l’environnement reste difficile à estimer. En effet comment savoir si le fils d’un délinquant a plus de chance de faire de la prison parce qu’il a hérité de particularités génétiques ou parce qu’il a baigné dans un environnement favorisant les conduites délinquantes ? Pour trancher on compare les comportements de vrais jumeaux (qui ont exactement les mêmes gènes) avec ceux d’autres individus pour voir si ils sont plus susceptibles d’adopter les mêmes comportements.
Les études visant à démontrer l’hérédité de certaines déviances ne sont pas nouvelles. Mais bien que l’existence de familles de délinquants, de consommateurs de drogues, de suicidés etc soit avérée, la part d’influence des gènes et de l’environnement reste difficile à estimer. En effet comment savoir si le fils d’un délinquant a plus de chance de faire de la prison parce qu’il a hérité de particularités génétiques ou parce qu’il a baigné dans un environnement favorisant les conduites délinquantes ? Pour trancher on compare les comportements de vrais jumeaux (qui ont exactement les mêmes gènes) avec ceux d’autres individus pour voir si ils sont plus susceptibles d’adopter les mêmes comportements.
Mais l’interprétation des résultats pose problème car pour plusieurs raisons la ressemblance elle même peut être acquise : il y a par exemple plus de similitudes comportementales entre des vrais jumeaux à 80 ans qu’à 8 ans4 ! De même, la plupart des études trouvent aussi des similitudes comportementales plus fortes entre faux jumeaux qu’entre frères et sœurs alors qu’ils n’ont pas plus de gènes en commun.
Autre méthode plus prometteuse : la comparaison de vrais jumeaux séparés dans l’enfance et placés dans des environnements différents. Mais les critiques existent aussi : d’abord parce que la ressemblance physique entre les jumeaux peut déclencher des réactions similaires de la part de leurs interlocuteurs. Ensuite parce que ces expériences reposent sur le fait que les deux jumeaux aient des vécus totalement différents alors que les services sociaux veillent à placer les fratries dans des familles équivalentes sur le plan socio-culturel et qu’ils partagent au moins le vécu de leur séparation. De plus, le recrutement de ces jumeaux se fait généralement par voie de presse et favorise donc ceux qui ont une conscience aiguë de leur gémellité. « Au final les travaux sur les jumeaux apparaissent peu convaincants même si on continue de se baser sur leurs résultats pour quantifier la part de l’hérédité et donc des gènes dans le comportement »5.
L’expérimentation animale
 Autre méthode très utilisée : celle qui consiste à utiliser des animaux et notamment des rats pour expliquer les comportements humains. On reprochera d’abord que le cerveau d’un rat et à fortiori son esprit ont probablement trop peu à voir avec ceux d’un humain pour pouvoir extrapoler (saviez-vous que chez les rats il est désormais établi que « le sucre raffiné a un pouvoir attractif plus fort que celui de la cocaïne »6 ?). D’autre part, comme les humains, les rats sont des animaux sociaux dont les esprits sont modelés pour interagir les uns avec les autres. Un rat isolé dans sa cage n’a donc rien d’un rat « normal » et son comportement nous en apprend aussi peu sur celui de ses congénères que celui d’un enfant sauvage sur le notre…
Autre méthode très utilisée : celle qui consiste à utiliser des animaux et notamment des rats pour expliquer les comportements humains. On reprochera d’abord que le cerveau d’un rat et à fortiori son esprit ont probablement trop peu à voir avec ceux d’un humain pour pouvoir extrapoler (saviez-vous que chez les rats il est désormais établi que « le sucre raffiné a un pouvoir attractif plus fort que celui de la cocaïne »6 ?). D’autre part, comme les humains, les rats sont des animaux sociaux dont les esprits sont modelés pour interagir les uns avec les autres. Un rat isolé dans sa cage n’a donc rien d’un rat « normal » et son comportement nous en apprend aussi peu sur celui de ses congénères que celui d’un enfant sauvage sur le notre…
Reste que ces études concordent sur le fait que des rats placés dans des environnements exactement semblables peuvent avoir des comportements différents (l’un va par exemple développer une addiction à la cocaïne, l’autre non). Cela semble montrer qu’il existe bien des particularités d’ordre génétique qui influent sur la consommation de drogues… Mais en aucun cas cela ne permet d’affirmer quoique ce soit sur la part de l’innée et de l’acquis dans le développement de telles conduites. On a d’ailleurs récemment prouvé que le passage d’une petite cage vers un environnement plus stimulant (cage plus grande et équipée de jeux) peut suffire à réduire voire à faire disparaître la consommation de drogues de nos amis rongeurs.
Errements et égarements de la science d’antan
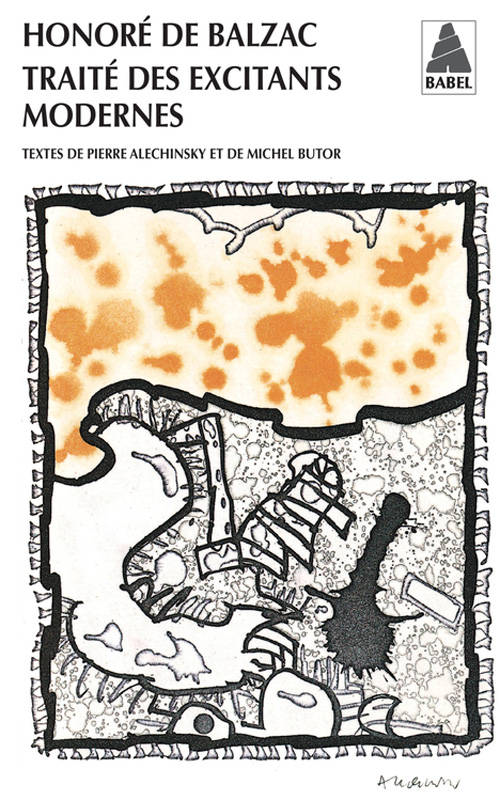 Réédité chez Babel cette année, le « Traité des excitants modernes » de Balzac fût publié en 1839 dans un ouvrage au titre évocateur (pathologies de la vie sociale). Au delà de son intérêt historique le lecteur moderne y trouvera surtout un divertissant bêtisier d’erreurs de compréhension des mécanismes d’action des drogues. Difficile en effet de ne pas sourire en lisant qu’un « certain vin de Touraine fortement alcoolisé, le vin de Vouvray combat un peu les influences du tabac » ou que la consommation de café majore les risques de combustion spontanée ! Surtout que tout cela est affirmé avec le plus grand sérieux, expériences scientifiques à l’appui.
Réédité chez Babel cette année, le « Traité des excitants modernes » de Balzac fût publié en 1839 dans un ouvrage au titre évocateur (pathologies de la vie sociale). Au delà de son intérêt historique le lecteur moderne y trouvera surtout un divertissant bêtisier d’erreurs de compréhension des mécanismes d’action des drogues. Difficile en effet de ne pas sourire en lisant qu’un « certain vin de Touraine fortement alcoolisé, le vin de Vouvray combat un peu les influences du tabac » ou que la consommation de café majore les risques de combustion spontanée ! Surtout que tout cela est affirmé avec le plus grand sérieux, expériences scientifiques à l’appui.
Ainsi à Londres, pour étudier les effets de ces trois substances, on a proposé à trois condamnés à mort de choisir entre la pendaison ou de vivre exclusivement de thé, de café ou de chocolat « sans y joindre aucun autre aliment ni boire d’autre liquide ». Les trois prisonniers choisirent évidemment la vie mais n’y gagnèrent qu’un sursis : celui qui dut se contenter de chocolat mourut au bout de deux ans « dans un effroyable état de pourriture », celui qui tira le thé vécu trois ans avant de succomber « maigre et quasi diaphane, à l’état de lanterne : on voyait clair à travers son corps ». Mais celui qui tomba sur le café eût moins de chance encore : on n’en retrouva qu’un petit tas de cendres, « comme si le feu de Gomorrhe l’eût calciné »… Inquiétant, n’est-ce pas ? On en vient nous aussi à se demander si « le chocolat n’est pas pour quelque chose dans l’avilissement de la nation espagnole ? ».
Et tout est du même genre. Un véritable ramassis de foutaises assénées avec une parfaite assurance scientifique. Mais derrière les tanins, les humeurs et les « transferts de forces » d’un organe vers l’autre, c’est un système primitif de compréhension du corps qui se dévoile et qui interroge : dans 150 ans, lesquelles des évidences d’aujourd’hui apparaîtront comme d’amusantes métaphores ?
Car si la pensée scientifique se caractérise en théorie par sa propre remise en question, en pratique elle apparaît souvent comme porteuse d’une vérité absolue. On lui demande alors d’éclairer la société sur des sujets complexes, avec une véritable foi dans sa capacité à tout expliquer. Pourtant l’Histoire montre bien que – particulièrement lorsqu’il s’agit de domaines de recherche encore naissants – le risque d’erreurs est important.
Remerciements
Isabelle Michot (documentation OFDT)
Maud Martin (documentation Stendhal)
Notes