L’iboga, miracle ou imposture ?
L’iboga est une plante psychotrope très puissante, traditionnellement utilisée dans certaines régions d’Afrique Noire par des sorciers et guérisseurs locaux. Au Gabon, elle est associée à la religion Bwiti et ses impressionnantes cérémonies liées au culte des ancêtres. L’ingestion d’une mixture à base d’iboga permettrait d’entrer en contact avec leur esprit. Selon certains chercheurs et d’anciens pharmacodépendants, elle aurait, par ailleurs, la particularité de guérir les addictions aux drogues telles que l’héroïne, la cocaïne, mais aussi l’alcool et les anxiolytiques. Dans un cadre rituel approprié, elle permettrait également une forme de psychothérapie intensive et radicale. Voyons un peu ce qu’il en est.
Une expérience bouleversante
En cette période d’hyper-médicalisation, l’iboga est une démarche visant à trouver d’autres voies que celle de la psychiatrie ou des médicaments. Une alternative à l’opposé du statut de patient assisté, soumis et docile, qui accepte de faire pipi dans une bouteille sous l’œil d’un psychiatre soupçonneux pour avoir sa méthadone.
L’iboga classée stupéfiant
Comme Asud le craignait, l’iboga a été classée stupéfiant et son usage est désormais interdit. Plusieurs accidents et 2 décès ont accéléré ce classement. À terme, cela risque de rendre plus problématique encore son usage traditionnel dans la forêt africaine où les autorités finiront par interdire son usage, sous la pression des Occidentaux.
Paradoxalement tous ceux qui ont tenté l’iboga déconseillent très vivement de tenter cette expérience sans un médecin. L’iboga est un redoutable hallucinogène. Alors attention chers petits drogués, il y a eu 2 morts en quelques mois en France ! Il s’agit d’une philosophie basée sur une expérience ponctuelle bouleversante, parfois d’une violence inouïe… Après avoir consommé la plante, le postulant se retrouve peu à peu plongé dans des dimensions inconnues de sa conscience. Selon des spécialistes du Bwiti, « l’iboga proposerait une voie de responsabilisation » pouvant permettre à certains de retrouver une « dignité originelle » en plongeant dans l’inconscient et les méandres de la psyché avant de renaître. Une expérience spirituelle intense qui pourrait, dans certains cas, permettre à l’individu d’en finir avec ses démons et d’affronter la vie en se forgeant de nouvelles armes.
L’iboga pour décrocher
L’un des principes actifs de l’iboga, l’ibogaïne, fut le principal constituant du Lambarene®, un médicament (retiré du marché en 1966) dont Albert Schweitzer et Haroun Tazieff se servaient à faible dose pour combattre la fatigue.
L’iboga qu’on trouve au Congo, au Cameroun et au Gabon se prend toujours dans le cadre de cérémonies bien précises. Soit lors de la cérémonie d’initiation où le « Banzi » (Nouvel initié qui s’apprête à suivre la voie de l’iboga) en prend durant 3 jours, soit à l’occasion d’événement précis tel un deuil. La consommation d’iboga a toujours lieu après une préparation soigneuse et une mise en condition appropriée qui implique une purification rituelle, un nettoyage total, des purges. et une période de jeûne et de recueillement. La cérémonie se déroule sur 3 jours avec des feux, des chants, des danses et de la musique durant tout le rituel. Le premier jour symbolise la la naissance, le second le voyage vers la mort, le troisième la renaissance et la connaissance. Une période de récupération est ensuite indispensable. La cérémonie laisse toujours les participants exténués.
Dès les années 50, des chercheurs s’intéressent à cet alcaloïde qui potentialise les effets analgésiques de la morphine. En 1962, un groupe de jeunes héroïnomanes teste l’iboga, sur la suggestion de collaborateurs de Timothy Leary qui cherchent des remèdes contre la dépendance à l’héroïne. Cinq ne retouchent pas à l’héroïne durant plusieurs jours. L’un d’entre eux, Howard Lotsof, s’enthousiasme et veut développer l’usage d’ibogaïne. La suite est un scénario digne d’un roman d’espionnage avec ses rebondissements, ses secrets, les intérêts de l’industrie pharmaceutique, les pressions du gouvernement et de nombreuses magouilles. En 1968, en pleine période hippie, les USA interdisent l’ibogaïne, censée provoquer des visions. Durant les années 80, Lotsoft, qui a replongé entretemps, redécroche avec l’ibogaïne et, à force d’activisme, réussit à mobiliser des laboratoires, des mécènes… et Act Up. Des programmes expérimentaux ouvrent aux Caraïbes et aux Pays-Bas. Le succès est mitigé. Les évaluations rigoureuses manquent. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour témoigner. Parfois instrumentalisées par les professionnels de la « décroche alternative », qui présentent l’iboga comme la panacée pouvant permettre de surmonter toutes les dépendances. Alors que de nombreux sites Internet se consacrent à cette plante, à ses usages traditionnels, médicaux et expérimentaux, avec ses partisans et ses détracteurs, un consensus informel semble pourtant se profiler. L’iboga ou l’ibogaïne auraient effectivement aidé quelques personnes à décrocher de certaines drogues, mais il ne s’agit en aucun cas du produit miracle ou du médicament que certains décrivent.
En cas de dépendance opiacée, l’iboga ne soulage absolument pas le manque. Prise dans un cadre rituel, la plante peut parfois provoquer une forte secousse psychique, une prise de conscience, parfois d’une redoutable violence, qui peut permettre de trouver les ressources internes pour surmonter l’envie de drogue. Puis, peu à peu, aider à résoudre les problèmes de dépendance, dans le cadre d’un processus de maturation. Selon les promoteurs de la bande à Lotsoft, tel Dana Beal (auteur de « The Ibogaine Story »), l’ibogaïne serait en fait plus adaptée pour résoudre les problèmes de comportements addictifs comme les dépendances au jeu, au sexe, voire aux stimulants comme la cocaïne.
Attention Bad trip
Mais attention. Si les techniques chamaniques fonctionnent dans les sociétés traditionnelles, dans des contextes religieux et culturels particuliers et avec des personnes familiarisées avec ces usages depuis des temps immémoriaux, il en va rarement de même avec les « touristes » occidentaux que nous sommes. Asud a rencontré de nombreux apprentis chamanes qui sont restés chéper sur leur branche.
Voici en résumé comment Vincent Ravalec explique l’expérience dans l’ouvrage « Bois sacré, Initiation à l’iboga » : « L’initié devenu visionnaire serait capable de communiquer avec ce que les Africains appellent l’esprit des ancêtres. Il s’agirait d’une immersion dans une espèce de bibliothèque vivante, une mémoire généalogique où lui serait projeté le film de sa vie et celle de sa lignée, mais sous un angle totalement inédit avec en bonus les coulisses du film, le tournage, l’intelligence du scénario. Tout ça avec la compréhension claire qu’il ne tient qu’à lui d’écrire la fin qu’il veut. » Ravalec insiste nettement sur le fait que l’iboga ne peut en aucun cas se prendre comme une drogue récréative. L’expérience comporte toujours une dimension pénible. La confrontation avec ses peurs, ses refoulements n’est jamais une partie de plaisir. Au Gabon, le Bwiti, ou religion de l’iboga, est une philosophie de vie, une voie vers la connaissance comme le yoga ou la voie de l’ayahuasca (autre plante psychotrope hallucinogène) d’Amazonie, qui nécessite une très forte motivation. Un travail permanent et dur. Si les témoignages et descriptions concernant l’iboga sont souvent spectaculaires et fascinants, tous mettent sérieusement en garde contre les expériences hasardeuses et dissuadent fortement d’en consommer en dehors des contextes rituels traditionnels. Certains expérimentateurs qui ont essayé d’autres plantes traditionnelles reconnaissent qu’avec l’iboga, ils ont eu très peur et que sans la présence d’un bon guide, ils auraient fait un sacré bad trip.
La teneur en principe actif de la plante peut, par ailleurs, varier sensiblement. Trouver le dosage optimum est donc plus qu’aléatoire.
On peut aussi décrocher tout seul, comme un grand, à la rigueur avec un peu de Subu ou de métha en doses dégressives en quelques jours. Le challenge c’est de ne pas recommencer.


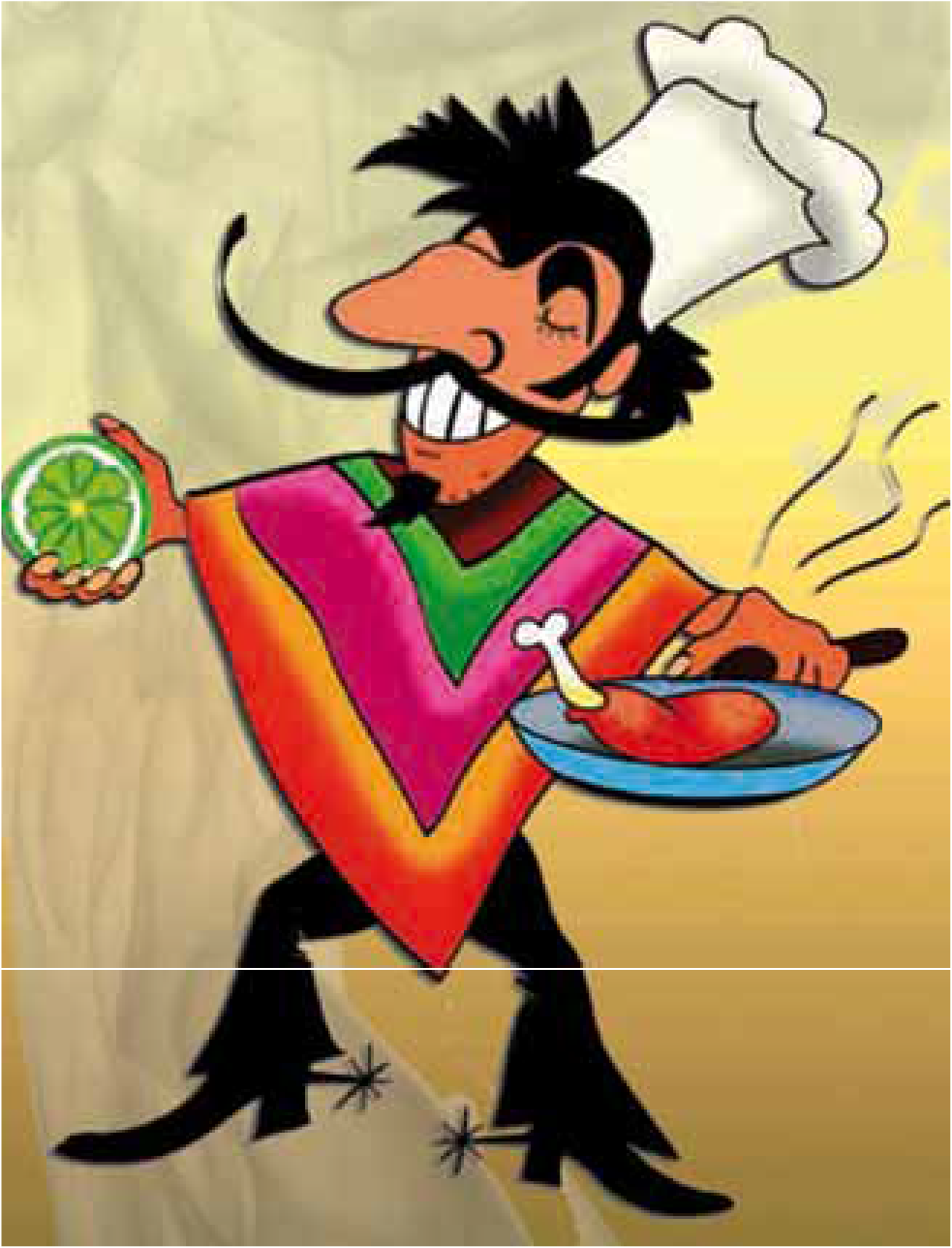 Ne plus avoir à « cuisiner »
Ne plus avoir à « cuisiner » La fin totale du paquet et du fric
La fin totale du paquet et du fric «… les programmes méthadone, véritable pierre angulaire de la lutte contre la toxicomanie. »
«… les programmes méthadone, véritable pierre angulaire de la lutte contre la toxicomanie. »




 L’Ordre National de Pharmaciens et Asud sont associés pour dénoncer cette situation qui, loin de résoudre les tensions éventuelles, est une source de conflit supplémentaire entre usagers et pharmaciens.
L’Ordre National de Pharmaciens et Asud sont associés pour dénoncer cette situation qui, loin de résoudre les tensions éventuelles, est une source de conflit supplémentaire entre usagers et pharmaciens. Rappelons au contraire que, grâce à l’introduction des traitements de substitution dans les années 90, le nombre d’agressions de pharmaciens d’officine par des toxicomanes n’a cessé de baisser.
Rappelons au contraire que, grâce à l’introduction des traitements de substitution dans les années 90, le nombre d’agressions de pharmaciens d’officine par des toxicomanes n’a cessé de baisser.

 Ouvrir le dialogue
Ouvrir le dialogue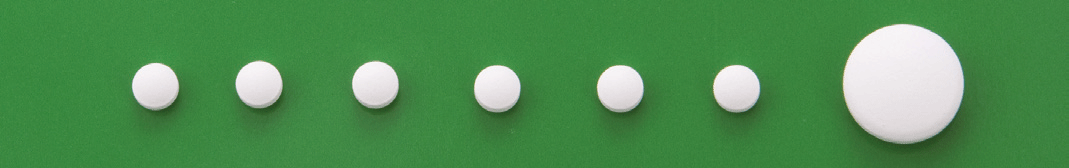





 La faute au tox
La faute au tox