Le temps de l’armistice
Enfin, la politique des drogues va marcher sur ses deux pieds : réduction des risques liés à l’usage pour ce qui est la santé, réduction des dommages causés par le trafic pour ce qui est la sécurité. Il reste encore une longue marche pour construire les régulations de l’avenir mais au moins, on sait désormais dans quelle direction aller. Le continent américain a déjà basculé dans l’ère nouvelle et le grand retournement menace désormais les Nations unies. Les Français ne l’ont pas compris, parce qu’ils restent enfermés dans l’alternative « guerre à la drogue ou légalisation ». Comme la légalisation des drogues n’est pas imaginable, du moins dans un avenir prévisible, la guerre à la drogue poursuit son escalade. Ces dernières années pourtant, les nouvelles d’outre-Atlantique n’ont cessé de tomber en cascade : « La guerre à la drogue est perdue ! » Qui s’en soucie ? Dans notre belle république, la guerre à la drogue doit se mener coûte que coûte.
Une forme d’armistice
Or justement, ce n’est déjà plus le cas sur le continent américain. À l’ONU même, où pourtant le langage le plus diplomatique est de rigueur, il n’est plus possible de masquer les conséquences de ce retournement. Dans un article publié dans Le Monde.fr, Bernard Leroy a d’ailleurs tenté d’alerter les Français : « La légalisation des drogues : une illusion », écrit-il ce 12 avril 2012. Que se passe-t-il exactement à l’ONU pour que cet éminent avocat général, qui a longtemps représenté la France au sein de cet organisme, estime nécessaire de discuter cette illusion ? Le Guatemala a bien demandé la légalisation des drogues, mais en quoi ce petit pays peut-il provoquer un tel émoi ? Un autre article publié dans Le Monde peu après aurait dû le rassurer : Barack Obama était sans équivoque, « Pour les États-Unis, la légalisation de la drogue n’est pas une option » (Le Monde, 20 avril 2012). S’il n’est effectivement pas question de légalisation de drogues, ce qui est à l’ordre du jour aujourd’hui, c’est plutôt une forme d’armistice.
C’est précisément ce qu’a proposé la Maison Blanche au sommet des Amériques en Colombie, ce 20 avril 2012 : « L’incarcération de masse est une politique du passé qui ignorait la nécessité d’avoir une approche plus équilibrée face à la drogue, entre santé et sécurité », a ainsi déclaré Gil Kerlikowske, le responsable de la politique de lutte contre les drogues aux États-Unis. Voilà qui peut ressembler à une simple pétition de principe. La santé d’une part, la sécurité d’autre part, des objectifs sur lesquels tout le monde peut se mettre d’accord. Mais la prise de conscience de « l’incarcération de masse » est bien un tournant majeur. C’est le cœur de la discussion puisque dans ce même article, Bernard Leroy tient à rappeler qu’il est possible de ne pas incarcérer les usagers drogues sans renoncer à la prohibition. Sans doute. Il n’en reste pas moins que partout dans le monde, usagers de drogues et petits trafiquants remplissent pour moitié les prisons.
L’incarcération de masse
Mais nulle part au monde, l’incarcération n’a été aussi massive qu’aux États-Unis. Un livre vient de dénoncer ce scandale : The New Jim Crow : Mass Incarceration in the Age of Colorblindess, que l’on pourrait traduire par « Les nouvelles lois de ségrégation : L’incarcération de masse au temps du déni des discriminations raciales ». En deux décennies de tolérance zéro, 30 millions de Blacks et quelques autres minorités ont été incarcérés pour une infraction liée aux drogues. Ces pratiques discriminatoires ont longtemps été masquées par l’idéologie « Law and Order » qui sévit depuis les années Reagan, et que les Américains ont réussi à propager dans le monde entier. Dans les séries TV ou les films, les trafiquants de drogue sont toujours des Noirs, et c’est effectivement le cas dans la rue.
Mais comme le montre Michelle Alexander, auteure de ce best-seller, l’essentiel de ce marché se passe ailleurs. Les Blancs consomment plus de drogues illicites que les minorités et ils achètent leurs produits en appartement, dans les milieux festifs et plus récemment, sur le Net. Les quelque 2,5 millions d’incarcérations par an ont brisé des millions de vies, avec pour principale conséquence l’exacerbation de la violence et l’enferment dans la délinquance ou l’exclusion des victimes de la répression. La démonstration de Michelle Alexander ne laisse pas de doute : la lutte contre « la » drogue a pris la relève d’une ségrégation qui, depuis le mouvement des droits civiques, ne pouvait plus s’afficher. Le vingtième siècle se termine ainsi par cette dernière grande tragédie, dont les conséquences sociales et politiques vont peser longtemps sur les États-Unis. Il ne sera pas facile de sortir de ce piège qui exige une profonde réforme des administrations de la justice et de la police, non seulement au niveau fédéral, mais dans chaque État. Impossible sans un vaste mouvement d’opinion prenant conscience que la guerre à la drogue a servi de cache-sexe à une ségrégation raciale qui est aussi sociale.
Sortir du piège
La guerre à la drogue a ravagé le continent américain. Au Nord, les incarcérations massives d’usagers de drogues et de trafiquants de rue n’ont limité ni le nombre des consommateurs ni le marché des drogues. Au Sud, la guerre aux narcos n’a limité ni les énormes profits ni l’emprise mafieuse de ces organisations criminelles, qui menacent les démocraties par la corruption et la sécurité des citoyens par leur violence. Comment sortir de ce piège ? Rompre avec la démagogie et prendre au sérieux la question des drogues est le seul chemin. Bien sûr, le marché noir est dû à la prohibition, mais le système prohibitionniste est devenu une réalité internationale aussi difficile à réformer que les règles du commerce international, la financiarisation de l’économie et les paradis fiscaux. Le débat sur la prohibition des drogues est nécessaire – comme d’ailleurs sur toutes ces questions de fond – mais au-delà des positions de principe, pour agir avec efficacité, il faut prendre acte des réalités. Que peut-on faire aujourd’hui même dans le système tel qu’il est, pour enclencher une logique de changement ? C’est ce tournant qu’a pris la Commission mondiale de la politique des drogues à partir d’un premier constat : y compris dans le système prohibitionniste, tous les pays n’obtiennent pas les mêmes résultats.
Dans la santé, un bon résultat, c’est une politique qui protège effectivement la santé, ce qui est d’ailleurs l’objectif initial de la prohibition des drogues. Mais dans la lutte contre le trafic, qu’est-ce qu’un bon résultat ? Le programme de l’ONU qui s’était engagé à « éradiquer les drogues » en dix ans a échoué en 2008, et une nouvelle expertise s’est mobilisée. Comme dans la réduction des risques liés à la consommation, il faut commencer par prendre acte des réalités. On estime généralement que la répression porte sur 5 à 10% de ce marché qui, comme tous les marchés, dépend de la demande. Ce qu’il faut éviter, c’est que la lutte contre le trafic renforce l’organisation mafieuse et la violence.
Renoncer à la tolérance zéro
C’est ce qui se passe lorsqu’on frappe les petits revendeurs. Les grosses saisies sont plus glorieuses, mais on aimerait bien savoir quelles en sont les conséquences sur le marché des drogues : qui profite de l’élimination de tels réseaux ? Les résultats doivent être évalués en termes de baisse de la criminalité et non pas en termes de saisies ou de nombre d’interpellations. C’est ce que recommande la Commission mondiale sur la politique des drogues dans son rapport de juin 2011. Mais c’était déjà l’objectif du Plan drogue 2009-2012 de l’Union européenne, car l’Europe a une certaine expérience en la matière. À Frankfort comme à Zurich ou Rotterdam, les villes européennes ont déjà mis en place des politiques locales pour réduire les nuisances liées aux drogues et protéger la santé des usagers de drogues : moins les usagers de drogues traînent dans les rue, mieux ça va pour tout le monde !
Le Portugal est donné en exemple parce que sa politique en a tiré les enseignements au niveau national. Les usagers, qui peuvent détenir jusqu’à dix jours de consommation, ne sont plus incarcérés, et le petit trafic de rue est toléré, à condition de ne pas gêner l’environnement. C’est tirer les leçons de l’expérience qui montre que plus les petits trafiquants de rue sont réprimés, plus le trafic est violent. Aux États-Unis, c’est le « miracle de Boston » qui fait figure de modèle1. Alors que cette ville faisait face à une hausse de la criminalité, associée au trafic de crack, une association caritative a proposé aux autorités de renoncer à la tolérance zéro (qui sanctionne systématiquement tout délit) pour se consacrer à la lutte contre la criminalité violente. Une démarche négociée avec les gangs, qui ont renoncé à l’utilisation d’armes à feu tandis que les faits non criminels étaient déjudiciarisés, la justice ne sanctionnant que les actes qui nuisent à autrui. Le commerce a été toléré, à la condition qu’il ne provoque pas de trouble ni dans l’environnement ni même au sein des gangs. Les résultats en termes de baisse de la criminalité ont été probants.
Aux marges de la loi
Le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Mexique ont commencé à dépénaliser l’usage. C’est le premier pas pour réorienter l’action des services répressifs. La France, elle, a adopté le modèle de la tolérance zéro en 2007, un an avant que son échec ne devienne probant aux États-Unis. Bien sûr, la France a manqué de places de prison, qu’il aurait fallu multiplier par 6 ou 7 pour atteindre les taux américains… Mais le nombre de personnes sanctionnées est monté en flèche. Or qu’a-t-on constaté ?
Dans les quartiers investis par le trafic, les comptes se règlent désormais avec armes à feu, ce qui n’était nullement de tradition dans les quartiers populaires français. En juin 2011, les fusillades et les morts ont fait scandale, et le débat s’est enfin ouvert sur la prohibition du cannabis. Si la prohibition est effectivement à l’origine du marché noir, l’escalade de la violence est-elle inéluctable ? La réponse est non. Tout dépend des objectifs et des pratiques des services de police. Quand un trafiquant a peur d’être balancé, il fait peur à son voisin. Quand un plan tombe, les règlements de compte suivent. La mairie de Saint-Ouen en a tiré les leçons. Après l’échec des interventions policières, elle a fait appel à des médiateurs, chargés de négocier entre trafiquants et habitants « pour éviter le pire ». Réduire les dommages causés par le trafic, c’est tout simplement le bon sens. L’autoproduc-
ponses, qui se bricolent aux marges de la loi. Préfigurant les régulations de l’avenir, ces bricolages seront d’autant plus efficaces qu’ils seront intégrés dans des politiques locales ou nationales comme au Portugal. L’armistice est la première étape. C’est seulement quand la plupart des pays auront pris ce chemin qu’il sera possible de renégocier les conventions internationales.
L’avenir se fabrique au présent
Peut-être la prohibition finira-t-elle un jour par s’écrouler d’elle-même, tel le mur de Berlin. Mais plutôt que d’attendre le moment où les États devront reconnaître leur impuissance, mieux vaut dès aujourd’hui expérimenter de nouvelles formes de régulation du marché en évaluant leurs résultats, comme l’ont été ceux de la réduction des risques liés à l’usage. L’avenir se fabrique au présent : il nous
faudra fabriquer nous-mêmes la sortie de ce système prohibitionniste. Ce que nous demandons aujourd’hui aux responsables politiques, c’est de prendre leurs décisions en connaissance de cause, en fonction de ce que l’on sait. Lors de sa campagne présidentielle, Hollande s’était engagé à soumettre la question du cannabis à une commission européenne. Les experts de l’Observatoire européen des drogues sont prêts. Il y a des acquis sur lesquels il n’y a plus de doute possible – c’est le cas de la dépénalisation de l’usage et de la détention associée à la consommation. D’autres question exigent un développement de l’expertise : évaluer les conséquences de l’application des lois, mieux connaître l’organisation du trafic de drogues, et lutter contre l’emprise des mafias – en France en particulier, où cette question a été curieusement négligée. Bref, prendre la question des drogues au sérieux. Est-ce trop demander ?















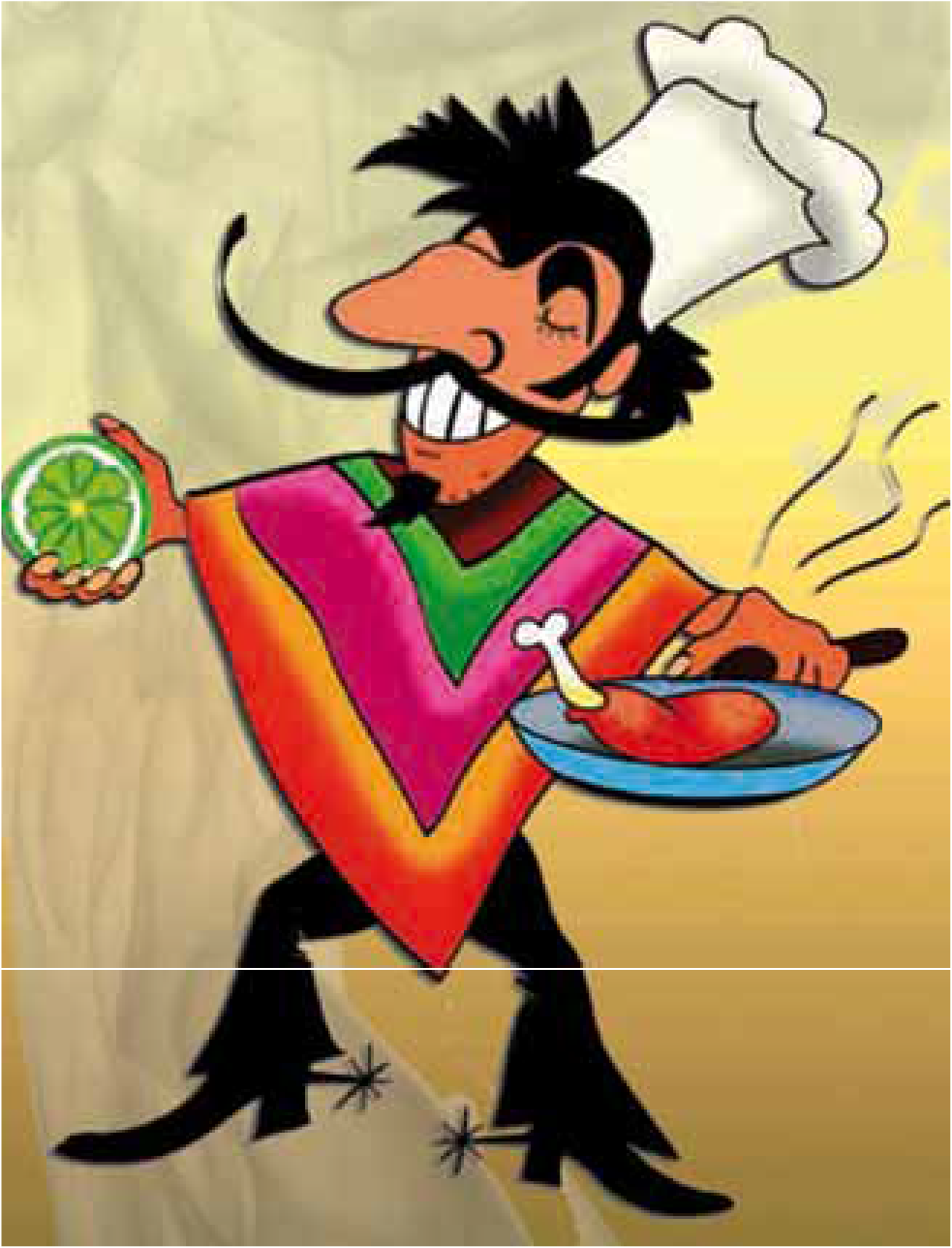 Ne plus avoir à « cuisiner »
Ne plus avoir à « cuisiner » La fin totale du paquet et du fric
La fin totale du paquet et du fric «… les programmes méthadone, véritable pierre angulaire de la lutte contre la toxicomanie. »
«… les programmes méthadone, véritable pierre angulaire de la lutte contre la toxicomanie. »



















