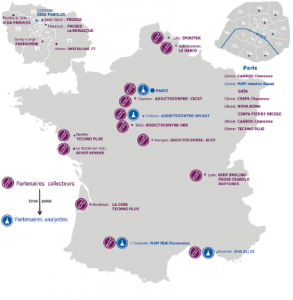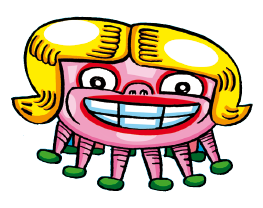Dans notre beau pays de France, on pénalise l’usage de drogues alors que l’alcool, lui, est partout : à chaque coin de rue, chaque moment important, aux repas, aux fêtes, en famille, entre amis, dans les moments de joie comme dans les coups de déprime… Un pays où la guerre menée au nom d’une certaine idée du « bien boire » est pourtant sans pitié pour ceux qui ne savent pas.
Les usagers de drogues sont souvent frappés par l’opposition entre les approches fondées sur l’abstinence à travers les mouvements dits « de 12 étapes » et celles des groupes d’autosupport issues de la réduction des risques, comme Asud. Il est important de rappeler que ces approches ont pu se succéder dans nos parcours. Les programmes fondés sur l’abstinence s’adressent à des gens qui sont eux aussi les bénéficiaires de prévention des maladies infectieuses, ou de stabilisation par le recours aux traitements de substitution aux opiacés (TSO). Les programmes fondés sur l’abstinence, le « recovery », comme disent les Anglo-Saxons, ont donc vocation à s’inscrire dans la panoplie des offres faites aux usagers.
Si l’on peut dire que se droguer, c’est se distinguer, se singulariser, se marginaliser ; boire, tout au contraire, c’est être normal, s’insérer, se fondre dans le groupe et dans le monde social car, comme le dit si bien la chanson, « il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres ! ». L’alcool est une drogue « pas comme les autres », d’abord, parce qu’il fait partie intégrante de notre patrimoine, de notre culture et de notre histoire, qu’il est, pour reprendre le mot de Barthes, notre « boisson-totem », notre psychotrope fétiche. Ensuite, parce que, à l’inverse des autres substances dont la société prescrit le « non-usage », la norme en fixe un usage « acceptable », sain, socialement intégré : le fameux « bien boire », si ancré qu’il rend même suspecte la personne ne consommant pas d’alcool.
LES DÉBOIRES DU MAL BOIRE
Mais en définissant ce « bien boire », on énonce inévitablement en creux l’existence d’un « mal boire ». Et si tout un ensemble de normes et de représentations vient imposer cette vision positive d’une certaine manière de boire perçue comme civilisée, ce même ensemble définit une « anormalité » et impose son modèle dominant pour définir ce qui est acceptable ou pas, légitimé par les discours « experts » et « savants » des corps constitués (police, pouvoir législatif, judiciaire, médical …) construisant un corpus paré du vernis de la vérité « scientifique », donc indiscutable.
Un ensemble de représentations et de discours qui trace une frontière, un mur même, entre ceux qui savent boire (le médecin, le travailleur social, le juge) et ceux qui ne savent pas (le patient, le sans-abri, le prévenu), entre sain et malsain, normal et pathologique, inclus et exclus. Est hors norme (donc hors jeu) celui qui boit le matin, celui qui boit seul, la femme qui boit, celui qui se présente alcoolisé à un moment ou à un endroit inapproprié, celui qui cherche dans l’alcool autre chose que la convivialité, le bien-vivre et l’amour du bon produit de qualité, vertus cardinales du « savoir boire ». Sont aussi hors norme, parce que ne sachant évidemment pas en faire correctement usage, les pauvres, les abimés de la vie, les fous, les malades, les jeunes…
Ceux qui sortent de la norme ne bénéficient pas plus de commisération que l’usager de drogues illicites, même moins peut-être parce qu’il est encore plus grave de transgresser une norme qui tolère et permet l’usage que d’affirmer sa marginalité en s’adonnant à des pratiques condamnées dès le départ. Certains d’entre nous subissent de plein fouet la violence qui frappe celle ou celui qui ne fait plus « comme les autres » et bascule sans l’avoir jamais cherché du groupe des inclus à celui des exclus. Être hors norme, ce n’est plus simplement être inapte à boire, c’est être inapte à vivre en société. « L’alcoolique est manipulateur, affabulateur et procrastinateur », nous apprennent de savants manuels d’alcoologie encore en vigueur. Il est enchaîné à son alcool et voit le monde à travers lui. Pas digne de notre confiance, il faudra s’en méfier, s’en garder même. « On me dit que mon alcoolisme est une maladie. C’est bien la seule maladie qui vous vaut de passer votre vie à vous faire engueuler ! » (un humoriste américain mort de cirrhose). Si c’est une femme, elle perd de sa féminité (« parce que je bois, je vois bien dans le regard des hommes, je ne suis plus une femme, juste un bout de viande pas fraîche qu’il faut vite consommer », dit une usagère). Si elle est mère, elle est inapte à éduquer ses enfants. C’est d’ailleurs ce que stipule l’article 378-1 du code civil : « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants… ». Si c’est un bénéficiaire de structures d’aide ou de soins, comme on lui prête forcément de ne pas savoir boire, on lui impose une prohibition ferme et non-négociable, comme l’illustre cette perle trouvée dans le règlement intérieur d’un centre d’hébergement : « Les faits les plus graves comme l’introduction d’armes à feu ou d’alcool seront sanctionnés d’une exclusion immédiate et définitive. » Les exemples sont légion pour illustrer combien la norme, au prétexte de santé publique, contribue à augmenter les souffrances de celles et ceux qui s’en écartent en les poussant à vivre dans le mensonge. Le fameux « déni » n’est pas autre chose que l’expression du farouche désir de rester chez les « inclus ».
UNE GUERRE QUI NE DIT PAS SON NOM
C’est d’une guerre qu’il s’agit, une guerre qui ne dit pas son nom et qu’on pourrait qualifier de guerre « propre » ou « froide » à l’encontre de certains usages et certains usagers d’alcool. Qu’il s’agisse de sanctions judiciaires (124 095 jugements au pénal concernaient l’ alcool en 2012, contre 53 113 jugements pour les stupéfiants), de procédures policières (70 000 interpellations chaque année pour ivresse publique et manifeste, IPM), de mesures administratives (arrêtés municipaux, préfectoraux, etc.), de pertes d’emplois, de refus de soins ou de prestations sociales, des centaines de milliers de personnes subissent chaque année les conséquences multiples de cette guerre larvée menée au nom d’une certaine idée du « bien boire ».
Une guerre hypocrite, puisqu’elle veille soigneusement à ne pas porter atteinte aux intérêts économiques astronomiques qui sont en jeu : le chiffre d’affaires de la filière française alcool représentait 19,6 milliards d’euros en 2011 (dont 15 milliards pour la seule filière viticole), l’alcool représente 10 % du budget alimentation des ménages et environ 15 % de la population active en tire ses revenus, directement ou non, totalement ou partiellement (production, distribution, restauration…). Une guerre sélective qui choisit ses cibles pour mieux faire oublier les intérêts qu’elle préserve : jeunes, femmes, précaires, polyusagers, celles et ceux qui sortent d’une norme d’usage imposée par un modèle social du « bien boire » sont les victimes de ce conflit ignoré… Les armes employées sont multiples : criminalisation, stigmatisation, exclusion de la société, chantage aux soins, injonction à l’arrêt… De la femme enceinte stigmatisée parce qu’elle consomme au sans-abri qui, à Marseille, se prend une amende de 11 € pour consommation d’alcool sur la voie publique, de la personne qui se voit refuser un traitement VHC ou autre tant qu’elle ne cesse pas de boire à l’usager de Caarud viré parce qu’il consomme de l’alcool (alors qu’il peut s’injecter dans les toilettes), nombreuses sont les victimes de cette guerre silencieuse. D’autant plus silencieuse que la parole des victimes n’est nulle part audible : pas d’autosupport pour les poivrots, pas de journal des z’alcooliques heureux, pas d’espaces pour recueillir leurs histoires, leurs expertises, leurs compétences et leurs besoins, et mieux construire ainsi des réponses efficientes à leurs difficultés. Restent juste aux personnes en difficulté avec leur usage le silence, la honte et la culpabilité, qui tuent beaucoup plus sûrement que l’alcool lui-même.
QUITTER L’ÉQUATION SIMPLISTE DU TOUT OU RIEN
La RdR historique a longtemps tenu la question des usages d’alcool à l’écart de son champ d’intervention, se justifiant par le statut licite de ce produit, tout en entretenant une forme de rejet teinté de mépris à l’égard d’une pratique vue comme réactionnaire, franchouillarde et… très prisée des forces de l’ordre ! Comme si, alors que le « toxico » méritait son statut de victime (de la loi, de la répression, du sida ou du VHC…), l’alcoolo, lui, méritait celui de coupable (d’être alcoolisé, de foutre le bordel, de battre sa femme et de provoquer des accidents au volant).
L’alcool n’est ainsi pas ou peu abordé dans les espaces où se pratique la RdR (Caarud, autosupport, festif…), et seulement avec le prisme du discours médicalo-centré fustigeant les mésusages. À ce titre, les expériences de RdR alcool conduites dans certains Caarud, dont celui d’Asud-Marseille (voir encadré), illustrent à la fois la pertinence à s’emparer de cette question mais aussi le choc culturel, tant pour les usagers que pour les professionnels, que provoque l’irruption de cet étrange objet à la fois omniprésent et absent. Pour autant, aujourd’hui, lorsqu’un usager de drogue qui se voit proposer matériel d’injection stérile ou de la substitution présente « un problème d’alcool », on continue quasiment partout à l’expédier en sevrage pour régler ce problème.
L’association SANTé ! se bat, comme le font d’autres sur la question des drogues, pour que soient reconnus les droits des personnes à consommer de l’alcool selon leurs besoins et désirs, et pas seulement selon des normes coercitives. SANTé ! se bat également pour que nos réponses se diversifient, qu’elles quittent l’équation simpliste du tout ou rien (alcoolique ou abstinent), qu’elles se démédicalisent en allant chercher du côté de la compréhension des manières de boire qui sont spécifiques à chacun. Pour SANTé ! comme pour Asud, il ne saurait y avoir de RdR sans autosupport. Mais pour qu’émerge cette parole combative et revendicative des « alcoolos », encore faut-il en finir avec l’autodisqualification qu’ils s’infligent, enfumés par l’idée d’être atteints d’une maladie honteuse dont ils seraient les seuls responsables et réclamant pour eux-mêmes la prohibition comme seule rédemption. Puisse donc cette contribution à Asud-Journal aider à réhabiliter les « paroles d’ivrogne ».
LA « PICOLOGIE » EN PRATIQUE
SANTé ! développe depuis 2015 avec Asud Mars Say Yeah un partenariat visant à développer une pratique de RdR alcool pour les personnes accueillies, usagères de drogues et souvent en situation d’exclusion sociale.
pratique de RdR alcool pour les personnes accueillies, usagères de drogues et souvent en situation d’exclusion sociale.
Une réflexion collective sur la place des usages d’alcool dans ce Caarud issu de l’autosupport, et la capacité de l’équipe à gérer les alcoolisations et à repérer et à répondre aux besoins des personnes usagères de drogues ET d’alcool a débouché sur le choix « d’accueillir avec alcool ». Autrement dit, de faire toute sa place à cette pratique qui scande souvent le quotidien des personnes mais qui doit rester à la porte des lieux de mise à l’abri.
Parce que boire dans la rue, c’est toujours boire dans l’urgence et dans un environnement hostile, exposé aux regards réprobateurs de la répression (à Marseille, les forces de police vident les canettes des usagers de la rue devant eux), pouvoir se poser à Asud, dans un cadre chaleureux et convivial, en se voyant proposer une collation et un verre, c’est d’abord restaurer les personnes dans leur dignité, y compris celle de « buveur ». C’est créer les conditions d’un « boire » apaisé, sécurisé, accompagné de discussions favorisant le « boire ensemble » et contribuant au projet communautaire. C’est aussi les conditions idéales de ce que l’on appelle à SANTé ! la « picologie », cet accompagnement des usages pour aider la personne à vivre au mieux ses consommations. On s’intéresse à comment les gens boivent, plutôt qu’à « combien », à ce qu’ils recherchent dans l’usage, notamment dans ce contexte en association avec d’autres substances : méthadone, Skenan®, Artane®, benzos… Tout ce qui fait glapir de nombreux professionnels de l’addictologie qui n’y voient que des pratiques nocives, là où l’usager vous parle de gestion des effets, de dosage, de bénéfices et de stratégies du moindre risque. C’est enfin l’occasion de parler d’alcool autrement : de cesser d’en nier l’existence ou, au contraire, de dramatiser quand survient la crise qui pousse à imposer des réponses immédiates. Et, in fine, démontrer que l’idée selon laquelle il y aurait toxicos d’un côté et alcoolos de l’autre relève du fantasme entretenu par des intervenants qui tendent à caser les personnes pour mieux les « cerner ».
 C’est ce que dit Abdel, usager et administrateur d’Asud Mars Say Yeah : « L’alcool est depuis toujours un produit très largement consommé par les Asudiens, ce qui nous a amenés à en accepter l’usage au sein de nos murs. Pour limiter les risques associés et lorsque cela était possible, nous proposions des gobelets en plastique, sans les imposer mais en incitant tout de même à leur utilisation. C’est dans ce cadre que nous avons commencé un processus de formation à la RdR liés à la consommation d’alcool. Et une des premières difficultés a été de faire entendre à nos usagers que l’alcool est une drogue « comme les autres » et qu’à ce titre, ses utilisateurs sont des Asudiens « comme les autres ». »
C’est ce que dit Abdel, usager et administrateur d’Asud Mars Say Yeah : « L’alcool est depuis toujours un produit très largement consommé par les Asudiens, ce qui nous a amenés à en accepter l’usage au sein de nos murs. Pour limiter les risques associés et lorsque cela était possible, nous proposions des gobelets en plastique, sans les imposer mais en incitant tout de même à leur utilisation. C’est dans ce cadre que nous avons commencé un processus de formation à la RdR liés à la consommation d’alcool. Et une des premières difficultés a été de faire entendre à nos usagers que l’alcool est une drogue « comme les autres » et qu’à ce titre, ses utilisateurs sont des Asudiens « comme les autres ». »












 C’est ce que dit Abdel, usager et administrateur d’Asud Mars Say Yeah : « L’alcool est depuis toujours un produit très largement consommé par les Asudiens, ce qui nous a amenés à en accepter l’usage au sein de nos murs. Pour limiter les risques associés et lorsque cela était possible, nous proposions des gobelets en plastique, sans les imposer mais en incitant tout de même à leur utilisation. C’est dans ce cadre que nous avons commencé un processus de formation à la RdR liés à la consommation d’alcool. Et une des premières difficultés a été de faire entendre à nos usagers que l’alcool est une drogue « comme les autres » et qu’à ce titre, ses utilisateurs sont des Asudiens « comme les autres ». »
C’est ce que dit Abdel, usager et administrateur d’Asud Mars Say Yeah : « L’alcool est depuis toujours un produit très largement consommé par les Asudiens, ce qui nous a amenés à en accepter l’usage au sein de nos murs. Pour limiter les risques associés et lorsque cela était possible, nous proposions des gobelets en plastique, sans les imposer mais en incitant tout de même à leur utilisation. C’est dans ce cadre que nous avons commencé un processus de formation à la RdR liés à la consommation d’alcool. Et une des premières difficultés a été de faire entendre à nos usagers que l’alcool est une drogue « comme les autres » et qu’à ce titre, ses utilisateurs sont des Asudiens « comme les autres ». »