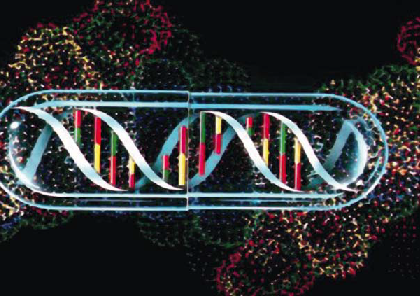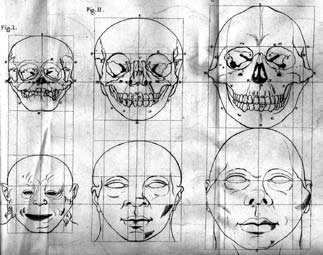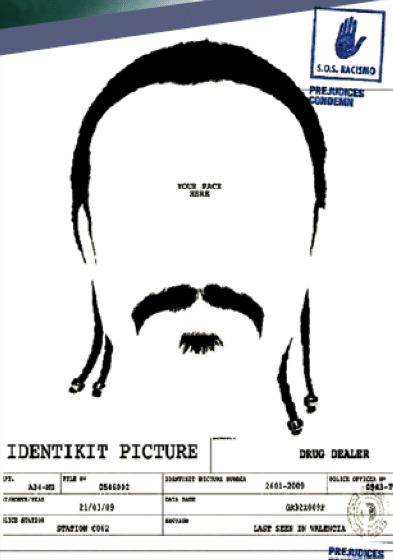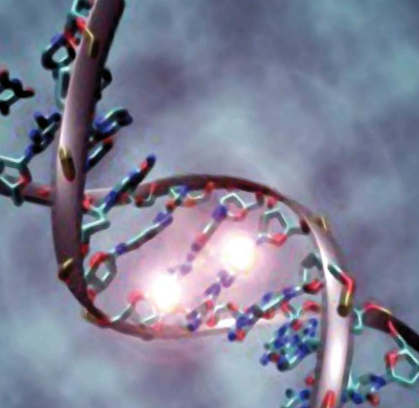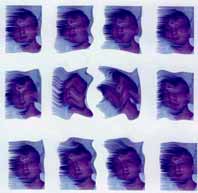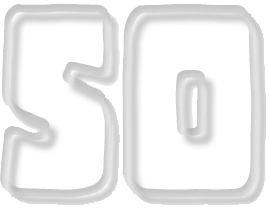Aux Origines d’Asud, le « self help » hollandais.
En 1992, l’un des concepteurs du projet ASUD est un sociologue d’origine égyptienne, Abdallah Toufik, soucieux de prolonger au pays des Droits de l’Homme une organisation européenne d’auto-support, le European Interest Group of Drugs Users (E.I.G.D.U.).
Cette filiation a fixé précocement les bases théoriques d’Asud. Le modèle « sociétal » , dont le Junky bond hollandais fut l’incarnation principale durant les année 80, est une version européenne, humaniste et sociale du self support. Ce modèle accorde une part prépondérante aux questions sociales et politiques dans la dynamique d’un groupe d’auto-support d’usagers de drogues. L’analyse de la consommation de substances illicites est entièrement organisée autour de la prohibition des drogues et de ses effets socio-économiques.
Ce modèle européen, basé sur la reconnaissance de la citoyenneté des consommateurs de stupéfiants est adopté par les usagers de drogues(u.d.) français, dans un pays où la question des droits de l’homme est un médiat fréquent des groupes opprimés (immigrés, taulards etc…). Logiquement la première mesure d’urgence réclamée par ASUD est la dépénalisation de l’usage de toutes les drogues .
ASUD se structure comme n’importe quel groupe antiprohibitionniste qui veut exercer une pression sur l’opinion pour changer la loi. Les non-usagers désirant se joindre au combat sont prévus par les statuts (40% des instances associatives). La création d’Asud en 1992 se fait autour d’un projet de journal de prévention, à la fois outil de propagande et organe de réduction des risques liés à l’usage de drogues, susceptible d’être toléré malgré le contexte répressif français. Les préoccupations sanitaires apparaissent naturelles, puisque visant à l’amélioration des conditions de vie des u.d., mais elles sont également articulées à une nécessaire modification du cadre légal régissant les stupéfiants.
Cette primauté du politique sur les objectifs de santé publique se double d’un certain ressentiment à l’égard d’un système de soins dont on conteste les postulats. L’équation drogué=malade, si elle satisfait la profession médicale qui y voit une possibilité d’arracher les u.d. au statut de délinquant, n’est en rien partagée par des militants d’Asud, pour lesquels l’argument majeur de la dépénalisation est à rechercher dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Asud: quels militants ?
 Dans toute tentative d’analyse de la question de l’usage de drogues, il est essentiel d’intégrer l’importante question de la culpabilité morale générée par le caractère illicite de la consommation.
Dans toute tentative d’analyse de la question de l’usage de drogues, il est essentiel d’intégrer l’importante question de la culpabilité morale générée par le caractère illicite de la consommation.
Ce problème structurel, dont les potentialités dévastatrices ne sont plus à démontrer depuis Freud, brouille toutes les données concernant les u.d. Il perturbe leur propre discours, il modifie le regard qu’ils portent sur eux-mêmes, il accentue tous les aspects négatifs consécutifs de la répression.
A l’intérieur d’un groupe de pairs comme N. A. (Narcotic anonymous), le self-help est principalement basé sur cette grande culpabilité inhérente à l’usage de drogues. Le projet individualiste et volontariste de N.A. est semblable à la machine « bull worker « des années 50. Il y a « avant », des loques mentales sous l’emprise de la drogue, incapables de différencier le bien du mal. Il y a « après », le « dépendant » sevré et abstinent puise sa force de conviction dans le dégout que lui inspire son double démoniaque d’avant: le toxico. Grâce aux puissants véhicules moraux qui s’appellent déculpabilisation et volonté d’expiation, les ex-drogués sont capables de nombreux sacrifices. Certains d’entre eux utilisent cette énergie pour enfin aimer, travailler s’insérer dans la société de leur semblables au prix de la négation d’une partie d’eux-mêmes.
Ce cheminement psychologique est parfaitement compréhensible. L’usage de drogues, particulièrement l’usage intraveineux, est un acte lourd, à la fois provocateur et initiatique. Très souvent il est l’aboutissement d’un processus antérieur de défi aux normes sociales. D’autre part, les consommateurs d’héroïne ou de cocaïne sont rapidement soumis à une dure pression financière. Cette impérialisme de la question monétaire dans l’organisation sociale des u.d. rapproche logiquement ce groupe humain de l’univers de la délinquance. Face à la nécessité de drainer chaque jour de fortes sommes, la plupart revendent, quelques-uns travaillent (parfois très dur), d’autres volent, bref beaucoup se retrouvent un jour ou l’autre à devoir gérer d’un point de vue éthique, la transgression de la loi.
Cette accumulation de transgressions ajoutée à la réprobation morale que l’ensemble de la société jette sur l’usage de drogues, peut devenir absolument intolérable. Plutôt que de continuer à préserver quelques principes, à l’intérieur de choix éthiques personnels, certains u.d. préfèrent abdiquer tout sens moral. Devant la difficulté de se concevoir à l’intérieur de la transgression, mieux vaut briser le miroir, et céder à une spirale de l’abandon et à son cortège de déchéances.
A l’inverse de ce schémas très proche des stéréotypes dominants, d’autres u.d. essayent vaille que vaille de maintenir un cap fragile entre le bien et le mal à l’intérieur de l’usage de drogue. Un certain nombre de questions têtues viennent relancer le libre arbitre des usagers, par delà le confortable refus des valeurs bourgeoises. Le problème du partage dans un contexte de pénurie de produit, l’attitude commerciale des revendeur(ses), l’attitude face à la police, le comportement adopté par rapport à la prostitution, autant de facteurs qui replacent l’individu face à ses propres choix.
Cette persistance du libre-arbitre en contradiction avec la prétendue aliénation provoquée par la drogue doit également se concevoir en fonction de degré de culpabilité engendré par l’acte lui-même. Certains u.d. n’ont pas vécu l’usage de drogues comme péché mortel. Leur expérience les conduit à mettre en doute la pertinence d’une condamnation morale sans appel de produits parfois consommé dans la joie et la convivialité. L’opposition artificielle établie par la société bourgeoise entre La drogue et La vie ne correspond pas à leur propres critères, où la vitalité est parfois synonyme de consommation et l’abstinence trop proche de la stérilité et du néant. Par ailleurs, ces réfractaires au« fléau de la drogue », ont su préserver des repères moraux, sans pour autant renoncer à la transgression, mais en conservant suffisamment d’espace narcissique pour pouvoir utiliser le succès professionnel ou mondain comme signe de reconnaissance sociale.
Le succès rapide du journal d’Asud est certainement lié à cet espace laissé en jachère par l’ensemble des « intervenants en toxicomanie ». Toute une catégorie d’usagers est restée longtemps désemparée, déroutée par des réponses thérapeutiques inadaptées et des stéréotypes moraux dans lesquels elle ne se reconnait pas. Souffrant d’un lourd déficit identitaire à l’extérieur de l’usage de drogues, ils se jugent néanmoins incapables de gérer à long terme les contraintes économiques et sociales qui pèsent sur le « toxicomane ». Souvent partiellement socialisés, ou tout au moins candidat à un mode de consommation ne mettant en péril ni leur santé ni leur vie sociale, ils sont les clients potentiels idéal de la substitution.. L’émergence d’Asud permet à ce type d’usager de ré-occuper un espace plus conforme aux catégories mentales qui sont les leurs, sans devoir pour autant rompre avec l’usage de drogues.
Il s’agit d’une démarche humaniste qui réintroduit l’individu au coeur de son destin. L’être humain est censé pouvoir gérer l’usage de nimporte quelle molécule chimique, créée par lui-même pour son confort et son plaisir, à condition que ne viennent pas s’intercaler la volonté de puissance d’autres hommes. Mieux, pour déterminer ce qui transforme le plaisir en aliénation, Asud propose d’utiliser l’héritage philosophique du XVIIIe siècle. La Raison, la science, le courage individuel, autant de ressources déniées jusqu’alors aux « toxicomanes », mises au service de la gestion des produits stupéfiants. Cet appareillage intellectuel et moral permet de dénoncer ce qui socialement et politiquement maintient les usagers dans une position délinquante. Contrairement aux propos de certains sur le « contrôle social » , le souci d’intégration des usagers est une victoire de la liberté. Cette revendication normative est avant tout citoyenne, mais pour comprendre cela il faut rompre avec l’exhibitionnisme et une forme de masochisme très judéo-chrétien qui caractérisent l’image des drogués dans la culture occidentale . Le milieu des intervenants en toxicomanie s’est fait une spécialité depuis vingt ans de parler au nom des pauvres « toxicos », lesquels sont de fait privés de toute parole intelligible, en dehors du rituel consacré (moi, toxico, prostitué etc…). Le Journal d’Asud, en se réapropriant cet outil symbolique qu’est le Verbe a commis un sacrilège. La question du sacrilège est bien le coeur des problématiques soulevées par l’auto-support. L’ensemble de nos propositions de travail sur la réduction des risques procède d’un postulat effrayant: l’usage d’héroïne ou de crack est un choix positif, opéré délibérément par un cerveau comptable des avantages et des inconvénients imputables à cette consommation. Ce qui devient aliénation, ce qui l’a toujours été et le sera toujours, ce sont les conditions infamantes et dégradantes dans lesquels la société maintient cet usage. L’aliénation, c’est la volonté de soumission et d’asservissement que font peser des hommes sur d’autres hommes, que le prétexte en soit la race les habitudes sexuelles ou la consommation de drogues.
Ce discours révolutionnaire scandalise non seulement les professionnels du secteur spécialisé, mais également, la plus grande partie des usagers eux-mêmes. En rupture avec plusieurs décennies d’auto-apitoiement et de misérabilisme, l’image de l’usager-de-drogues-responsable-de-ses-actes élimine toutes possibilités de recours au parachute social, sanitaire et juridique élaboré parallèlement au concept de « toxicomane ». Semblables aux « oncles Tom », libérés brutalement par la cavalerie nordiste et refusant de quitter leur bon « masta », les u.d. découvrent l’intérêt paradoxal du statut d’irresponsable. Le « toxicomane », catégorie singulière de sous-citoyen reconnu par la loi du 31 décembre 1970, n’est censé ni tenir une promesse, ni endurer les contraintes d’un emploi salarié, ni fonder une famille. Tout ce qui lui est demandé est de se soigner, ou au minimum d’en faire la demande formelle. Que ce soin dure ensuite 20 ans ou toute une vie, peu importe…
Les usagers d’Asud vont donc en peu d’années mesurer les ravages psychologiques que la culture du déni a entraîné, y compris au travers de leur propre mode de fonctionnement.
L’impossible communautarisme
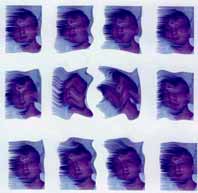 La redéfinition de l’image des usagers de drogues recèle pour les militants d’Asud de fortes problématiques identitaires. Il s’agit certes de changer la loi, mais pour construire un nouveau modèle d’usager qui supplante le « tox » dans l’imaginaire des consommateurs. Enfin il s’agit surtout de préserver sa propre santé tout en utilisant des drogues, ce qui diffère d’une démarche purement abolitionniste se référant exclusivement aux Droits de l’Homme.
La redéfinition de l’image des usagers de drogues recèle pour les militants d’Asud de fortes problématiques identitaires. Il s’agit certes de changer la loi, mais pour construire un nouveau modèle d’usager qui supplante le « tox » dans l’imaginaire des consommateurs. Enfin il s’agit surtout de préserver sa propre santé tout en utilisant des drogues, ce qui diffère d’une démarche purement abolitionniste se référant exclusivement aux Droits de l’Homme.
Les militants d’Asud se sont reconnus. Lors de l’essor du réseau entre 1993 et 1996, on a pu noter une certaine homogénéité des premiers militants.
Si leur origine sociale est extrêmement disparate, la majorité d’entre eux est constitué par des hommes, âgés de 30 à 40 ans, ex-injecteurs d’héroïne et sensibilisés à la rdr par le biais de la substitution. Pour ces victimes de la répression de l’usage , se retrouver et parler de drogues comme les vicomtes de la chanson (quand un vicomte etc…) possède une dimension réellement ludique. Un enthousiasme mêlé d’euphorie a présidé aux premières réunions nationales d’Asud . Les u.d. n’en revenaient pas de découvrir tant de semblables, animés par les mêmes idéaux de responsabilités et de citoyenneté. Très vite, le noyeau des militants historiques a pris conscience de sa spécificité, et l’optimisme de rigueur à l’époque a masqué les potentialités de dérives communautaires. Mais surtout, l’intérêt intellectuel que nous portons aux produits et leurs effets a permis d’ouvrir une question vierge en France, où le secteur spécialisé, nourri du bréviaire psychanalytique, considère les produits comme des symptômes, donc négligeables en termes de soins.
Sur cette base, le Journal d’Asud acquiert de l’audience. Les militants se sont découverts détenteurs de ce savoir jusqu’à présent dédaigné: « les drogues modes d’emploi » . Toute la cuisine interne du tox (techniques de shoot etc…) est mise à contribution pour nourrir l’information des professionnels de la rdr . Le succès d’un document comme « le manuel du shoot à risques réduits » renforce le sentiment de supériorité des drogués d’Asud sur une partie du secteur spécialisé, plutôt ignorants de l’appareillage technique des drogues.
Avec l’apparition de la substitution, les nouveaux militants sont moins préoccupés par les droits de l’Homme en général que par les mérites comparés de la méthadone et des sulfates de morphine. Or le postulat de départ était l’identité des u.d. avec les autres membres du corps social et la volonté de s’exprimer en citoyens libres, nantis de droits et de devoirs. Pour beaucoup de militants, ce postulat s’est transformé en conscience de besoins et de comportements spécifiques. Le Journal d’Asud devient un emblème pour des u.d., souvent très précarisés, humiliés, qui enfin se sentent valorisés par un média élaboré par leurs semblables. Ce nouveau contexte, que l’on peut qualifier de « tribal », hérite d’une partie des coutumes du monde de l’usage de drogues, par exemple, une forte consommation d’alcool (produit licite) pendant les réunions. Les non-usagers se sentent perdus dans une ambiance où l’on communique par codes. L’usage de drogues devient la seule légitimité au sein d’Asud, avec une préférence pour ses marques extérieures visibles. Le seul savoir reconnu est celui du consommateur, donc un savoir-être et non un savoir-faire. ASUD aspire à être un « syndicat de junkees. ». La question sociale est posée d’emblée du fait de l’appartenance au monde de la rue des nouveaux u.d. attirés par ASUD. Le groupe d’auto-support tente de servir d’institution-relais pour la réinsertion de marginaux ou d’anciens taulards. Une personne sdf est même embauchée à comme accueillant en 1996. Les contacts avec le monde associatif en lutte contre la précarité se sont multipliés entre 1994 et 1996.
Ce positionnement a permis de faire émerger au sein de l’association un certains nombre de débats essentiels. Tout d’abord la constatation évidente que contrairement aux discours « citoyens-comme-les-autres », l’usage de drogues est considéré par certains u.d., comme un mode de vie à part entière, les problèmes posés par la consommation de stupéfiants sont alors imbriqués avec la question sociale, y compris la contestation de valeurs bourgeoises liées au travail salarié. Dans le même ordre d’idée, le l’exercice de la vie associative, fait rapidement apparaître la nécessité pour un grand nombre d’usagers de faire l’apprentissage de la démocratie.
Paradoxalement, c’est leur volonté d’apparaître collectivement qui permet aux usagers d’évaluer tout le caractère réducteur de la fiction communautaire. C’est parce qu’ils sont enfin visibles qu’ils se découvrent tellement différents les uns des autres. La pseudo-culture des drogués est négative, directement issue de la répression. Les valeurs identitaires, traditionnellement prisées par les communautés, s’avèrent extrêmement complexes à manier dans le cadre des associations d’usagers.
Le communautarisme junk est une notion ambiguë et contestable souvent associée à des comportements délinquants (deal, violence, etc…). L’usage de drogues lui-même est relégué en-deçà de la démocratie par la police et la justice. Les rapports entre usagers sont réglés par l’intérêt financier ou affectif et la force brutale. Le fonctionnement tribal est difficile à conjuguer avec démocratie associative, car la tribu obéit à un chef auquel tous les membres s’identifient, l’unanimisme y est de rigueur. Le fonctionnement tribal suppose une confusion absolue entre vie privée et vie associative, d’où extrême acuité des conflits d’intérêt ou de pouvoirs qui prennent l’apparence de querelles familiales.
Le sucés d’une action »syndicale » d’Asud aurait supposé deux choses: un consensus sur le caractère « communautaire » et les signes d’appartenance à cette communauté, et une amélioration de la condition sociale des u.d. via l’auto-support. Or l’intégration sociale des u.d. accueillis se heurte aux réalités d’une société en crise depuis 25 ans, impitoyable pour tous les pauvres. Cette question renvoie le positionnement communautaire à ses vraies limites, c’est à dire bien au-delà de la question de l’usage de drogues. ASUD est incapable de combler les lacunes et les névroses engendrées par 10, 15 ou 20 ans d’exclusion sociale.
La réduction des risques : un succès pour l’auto-support.
Le principal volet de la rdr repose sur la possibilité pour les u.d. de prendre en charge une partie de leur traitement, démarche qui suppose le recours à la peers education . La gestion des produits de substitution par les patients eux-mêmes met en évidence le concept de responsabilité positive des usagers. Dans le même axe que les modifications de comportement induites par le décret Barzach, la diffusion des sulfates de morphine, de la méthadone, puis du Subutex, confirme le volontarisme des usagers pour préserver leur santé et s’insérer socialement. C’est bien parce qu’il sont au départ responsables de leur usage de substances illicites, que les patients substitués peuvent ensuite exercer un empire rationnel sur la consommation de ce qui, en l’état, demeure des stupéfiants. L’intérêt nouveau des laboratoires pour l’évaluation de l’effet des opiacés (euphorique ou non etc…) rejoint les préoccupations d’Asud. Un nouveau chapitre de la réduction des risques est ouvert par la nécessité non plus systématiquement « d’arrêter la drogue » mais plutôt de gérer sa consommation de stupéfiants. Tous ces nouveaux espaces de réflexion sont investis par des militants de l’auto-support de plus en plus professionnalisés.
Le contact permanent avec les institutions, la gestion des budgets, l’hostilité d’une partie du secteur spécialisé, autant de nouvelles données qui nécessitent un minimum de rationalité en interne. Le fonctionnement tribal d’Asud a donc été sérieusement mis en question. Conséquences, quatre ans après la création, on assiste dans tous les groupes au même recentrage: recul du bénévolat et des objectifs militants, démocratisation et rationalisation des rapports en interne.
L’auto-support français a trouvé un cadre légal, celui du soin. Usager des services sanitaires, plutôt qu’usager de drogues, voilà le nouvel espace qui nous est consenti . Nous l’utilisons en apprenant petit à petit à jouer le jeu consensuel qui fonde tous les groupes humains, le respect des règles.
Conclusion
La rigidité du cadre légal conditionne l’existence du volet militant de l’auto-support. Ce volet devrait plutôt être renforcé par un mouvement d’opinion non-ud, indigné par les atteintes aux droits de l’homme perpétrées au nom de la guerre à la drogue.
4 ans d’expérience au sein d’Asud montrent que
le travail des militants recouvre une réalité multiforme: problèmes légaux, problèmes sociaux, problèmes économiques. Sous couvert de Guerre à la drogue c’est souvent une guerre au pauvre ou au réfractaire social qui est menée.Cette confusion ne doit servir d’écran ni au citoyen, ni au législateur.
De nombreuses avancées dans la connaissance de l’effet des produits peuvent être réalisées grâce au travail d’usagers ou d’ex-ud lancés dans la rdr. Maintenue dans le champ sanitaire du fait de la loi, la substitution montre que nous sommes passé à une phase d’intégration des drogues dans la société. Notre travail porte également sur la construction d’une identité d’usager de drogues intégré socialement, question neuve et pratiquement vierge. Dans cette optique il est nécessaire de former de nouveaux professionnels, mi-oenologues mi-travailleurs sociaux, et surtout ne pas perdre de vue que si demain toutes les drogues étaient légalisées, le volet militant d’Asud disparaîtrait sans que cela résolve pour autant la crise sociale, économique, et encore moins le caractère impitoyable de la société de consommation.