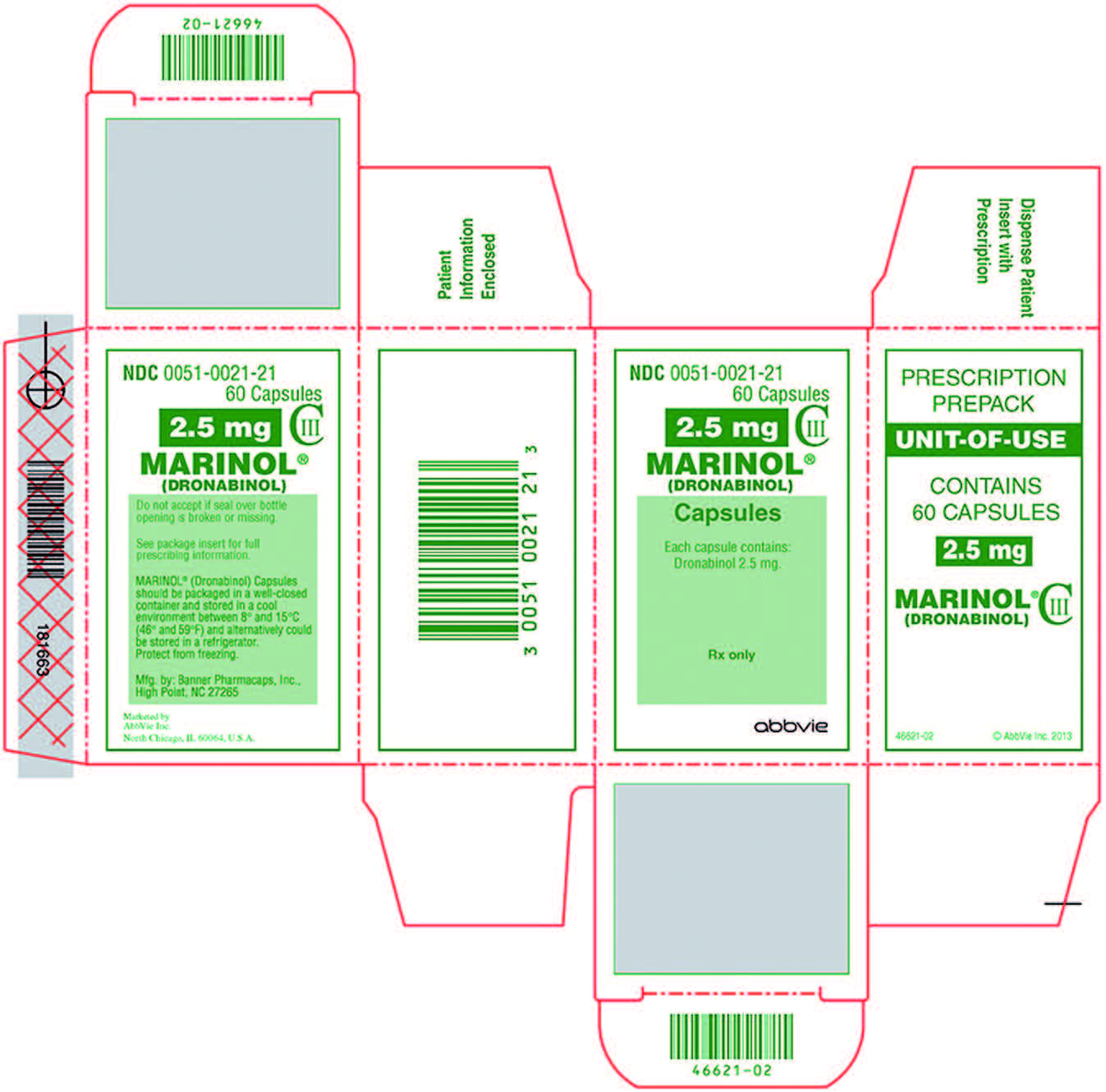La 62ème Commission des Stupéfiants de l’ONU, à Vienne, comme si vous y étiez !
J’avais 7 ans quand eut lieu la première Commission des stupéfiants de l’ONU. Je viens d’assister à la 62ème édition. La Commission on Narcotic Drugs (CND) se tient tous les ans à Vienne. Le « machin » a deux agences dans la capitale de l’Autriche : l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) et l’ONUDC (Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime). Sans compter l’OICS, j’en reparlerai. Vienne rassemble donc l’atome civil (Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima) et la drogue, ce que l’ONU appelle le « World Drug Problem » (WDP). Bref les deux plus dangereuses substances au monde : les matières fissiles et les poisons de l’esprit. Respect!
La prohibition des drogues, on ne le dira jamais assez, est une auto-prophétie (self-fulfilling prophecy) : elle met les drogues aux mains des groupes criminels puis, ce forfait accompli, s’empresse de lutter contre les liens qu’elle a construit entre le crime et « la » drogue. Mais je m’égare.
C’était ma première CND. J’étais tout excité. Et je ne fus pas déçu. Ceux qui connaissent le festival d’Avignon me comprendront : il y a la session officielle et le (foisonnant) « of ». La session officielle : une délégation plus ou moins fournie et/ou prestigieuse de chacun des près de 200 pays (193 exactement) qui composent les Nations Unies vient expliquer (dans le meilleur des cas) combien il respecte les trois conventions qui dictent la vie internationale des substances psychoactives : la convention (dite unique) de 1961 (ne jamais oublier « telle que modifiée par le protocole de 1972 »), la convention de 1971 sur les substances psychotropes et enfin celle de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Ajoutons qu’un organe quasi-judiciaire de 13 membres nommés pour leurs compétences, en particulier dans le champ du droit et de la médecine, l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS), créé en 1968 en accord avec la convention unique de 61 (telle que modifiée par le protocole de 72) veille jalousement à la scrupuleuse application des trois tables de la Loi. Son rapport annuel qui « désigne et condamne » (name and shame) les récalcitrants fut longtemps craint. Pour son grand malheur, c’est de moins en moins vrai. Mais elle parvient toujours à empêcher qu’aucun texte (forcément consensuel) de la CND ne comporte l’expression « harm reduction » (réduction des risques). Je sais, c’est dur à croire !
Cette session officielle ne peut être comprise que par ceux qui connaissent sur le bout des doigts le langage (complexe) de la CND, un peu comme les kremlinologues étaient seuls à comprendre pourquoi le camarade Popov, d’habitude au premier rang n’était désormais plus qu’au cinquième tandis que le camarade Lavrov avait pris sa place.
Chaque jour, après être passé par le portique de sécurité de l’entrée type aéroport (ceinture, montre et le reste), on monte au premier étage à côté de la salle plénière chercher le programme, on fait son choix : les réussites de la Turquie, du Cameroun ou des Philippines ( !) face au DWP, oui le fameux Drug World Problem ; les excuses du Surinam pour être mal situé géographiquement sur la route de la cocaïne alors évidemment… Ou bien encore le cannabis en Amérique du sud (détestable exemple donné par l’Uruguay et que bien d’autres pays de la région ont une furieuse envie de suivre, preuve que tout fout le camp !). Mais nulle part, hélas, les psychédéliques en médecine. Ce sera peut-être pour l’an prochain.
A côté donc de la session officielle, il y a les « side events » dans lesquels sont impliquées les ONG mais aussi certaines délégations officielles et parfois même les « organes » en particulier l’ONUDC et l’OMS. Disons le tout à trac : cette partie très « société civile » de la CND est la plus intéressante. On y croise même parfois des associations d’usagers, c’est dire ! J’ai ainsi assisté à de stimulantes sessions sur les amphétamines mais aussi sur la crise des opioïdes et le cannabis en Amérique latine. Et, pardon de me répéter, du Paraguay au Mexique, nombreux sont les pays que ça démange de légaliser comme l’Uruguay en 2013. Ah ! l’Amérique latine !
Bref, on a de quoi remplir sa journée d’autant qu’en sous-sol se trouve un restaurant qui, pour pas cher, nous offre une succulente nourriture. C’est grâce à Farid Ghehioueche, un vieil habitué, que j’ai découvert et le programme quotidien et le restaurant. Mais la CND touchait à sa fin. Combien je vais gagner de temps l’an prochain !
La CND, du 18 au 22 mars, était précédée par un « high level segment » les jeudi 14 et vendredi 15 mars, haut segment ministériel dont j’ai cru comprendre qu’il fut l’objet d’un bras de fer secret (mais connu de tous) entre la Russie et la France. Laissez-moi donc vous expliquer : nos amis russes s’appuient sur la « déclaration politique et plan d’action sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue » datant de 2009 (et dont on fêtait les dix ans, pour celles et ceux qui suivent). La France préfèrait la déclaration de l’UNGASS 2016 (United Nations General Assembly Special Session) plus progressive et un zeste moins guerrière. On se doute que si la Russie trouve la déclaration de 2009 « équilibrée », ce n’est pas bon signe ! Disons aussi que les Ungass sont rares : il y en eut une en 1998 (j’y étais pour Médecins du Monde) et une autre en 2016. Elles se tiennent non pas dans la vieille Europe malgré les excellents strudels du café Mozart mais à New-York, s’il vous plait. Et qui ne connait pas le siège du machin ne connait (presque) rien…
La plateforme française des ONG (MdM, Aides, FA, Asud, FAAT…) avait préparé, dans le cadre de la sixième reconstitution du Fonds mondial, un évènement de haut niveau sur l’accès aux médicaments du sida, de la tuberculose et de la malaria qui fut, de l’avis général, un franc succès. Il donne sacrément envie d’être à Lyon le 10 octobre prochain ! Et j’eus l’honneur de prendre pendant une bonne minute la parole au nom d’Asud dans le side event qui portait sur le changement des politiques en Afrique de l’Ouest.
On rentre de cette CND dans un état de délabrement physico-psychique qui fait peine à voir.D’autant qu’ il y a la doc. Ah, la doc ! J’en ai ramené une pleine valise en provenance de UNODC, de l’EMCDD, du WHO et de diverses ONG. Je ne lirai pas tout mais c’est tellement rassurant d’avoirde la bonne grosse doc juste à côté, prête à être utilisée…
Sinon la guerre à la drogue, la plus longue guerre du XXème siècle disait Thomas Szasz, la guerre à la drogue donc, continue. Y compris dans l’enceinte des Nations Unies où s’affrontent à fleurets plus ou moins mouchetés les partisans d’une « prohibition progressiste » pour reprendre les termes d’Ethan Nadelmann (Europe, Amérique du sud et presque un peu du nord) et ceux d’une « prohibition punitive » (Russie, Chine, Iran…). Dieu que la guerre à la drogue n’est pas jolie ! Surtout en Asie confrontée, il est vrai, à une épidémie de méthamphétamine…
A propos : le vendredi 15,, nous avons, à une trentaine, organisé un « Die In » devant le stand des Philippines orné d’un grand (et provoquant) portrait du président Duterte qui a si bien appelé la population à tuer les usagers de meth et les dealers de rue que ces exécutions extra-judiciaires ont déjà coûté la vie à plusieurs milliers de personnes. On s’est fait salement engueuler par la Sécurité qui nous a expliqué qu’à ce train-là, certains s’immoleraient par le feu devant le stand du Canada pour avoir légalisé la beuh récréative ! Tu vois le malaise !
Je ne saurais oublier la venue à Vienne d’Eric Correa qui défendit avec brio le désir de la Creuse de devenir le grenier français du cannabis thérapeutique et des liens qui se tissèrent alors avec la délégation paraguayenne. Béchir Bouderbala (oui, de Norml) qui, avec 45 ans d’avance sur moi, assistait, lui aussi à sa première CND, s’est juré de revenir. Pour ne pas être en reste, j’ai dit que moi aussi. Et pour en ramener un papier lumineux cette fois ! Ah, j’oubliais, j’eus droit à un petit bizutage de la plateforme (française) des ONG avec l’aide de IDPC (International Drug Policy Consortium, la crème). Mais rien de méchant, je vous rassure. Vivement la 63ème !
Bertrand Lebeau Leibovici



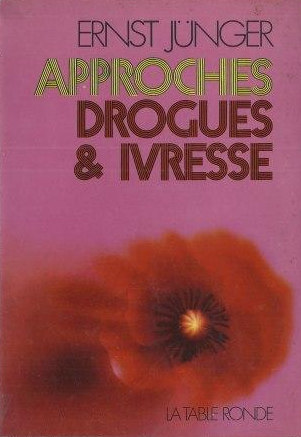 Si les stimulants sont absents de la Première Guerre mondiale ou presque (Dans
Si les stimulants sont absents de la Première Guerre mondiale ou presque (Dans 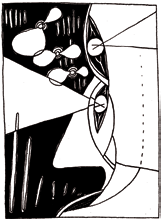 Venons-en au terrorisme. Certains témoins racontent que, le 13 novembre dernier, les tueurs du Bataclan tiraient de manière mécanique à hauteur d’épaule en tournant sur eux-mêmes. Debout au milieu des gens qu’ils abattaient, ils ne déviaient pas leurs tirs sauf pour réarmer. Ce qui expliquerait qu’il n’y ait pas eu plus de victimes, en particulier parmi ceux qui, terrorisés, se sont allongés les uns sur les autres, à leurs pieds. Voici, par ailleurs, comment le gérant d’un cybercafé décrit Salah Abdeslam le soir des attentats : « Ce qui m’a interpellé, c’est que cet homme avait l’air d’avoir bu ou consommé de la drogue. Son visage et ses yeux étaient gonflés – se souvient le vendeur. Il ressemblait à un des nombreux toxicomanes que l’on rencontre à Château-Rouge » ( Le Monde du 01/01/16). Les tueurs étaient-ils sous Captagon® (fénétylline), une amphétamine classée comme stupéfiant depuis 1986 et qui inonde littéralement les marchés clandestins moyen-orientaux depuis quelques années ? À Beyrouth, un prince saoudien s’est fait prendre en octobre 2015 avec, excusez du peu, deux tonnes de Captagon® ! Il s’apprêtait à prendre l’avion pour son beau pays. Et l’Arabie saoudite vient d’annoncer une prise de cinq millions de pilules d’amphétamines (lepoint.fr, 27/12/15), avec peine de mort à la clé pour les trafiquants. D’après les chiffres de l’Organisation mondiale des douanes, la quantité de pilules saisies dans les pays de la péninsule arabique a fortement augmenté ces dernières années : plus de 11 tonnes de Captagon® en 2013, contre 4 seulement en 2012 (Sciences et Avenir du 17/11/15).
Venons-en au terrorisme. Certains témoins racontent que, le 13 novembre dernier, les tueurs du Bataclan tiraient de manière mécanique à hauteur d’épaule en tournant sur eux-mêmes. Debout au milieu des gens qu’ils abattaient, ils ne déviaient pas leurs tirs sauf pour réarmer. Ce qui expliquerait qu’il n’y ait pas eu plus de victimes, en particulier parmi ceux qui, terrorisés, se sont allongés les uns sur les autres, à leurs pieds. Voici, par ailleurs, comment le gérant d’un cybercafé décrit Salah Abdeslam le soir des attentats : « Ce qui m’a interpellé, c’est que cet homme avait l’air d’avoir bu ou consommé de la drogue. Son visage et ses yeux étaient gonflés – se souvient le vendeur. Il ressemblait à un des nombreux toxicomanes que l’on rencontre à Château-Rouge » ( Le Monde du 01/01/16). Les tueurs étaient-ils sous Captagon® (fénétylline), une amphétamine classée comme stupéfiant depuis 1986 et qui inonde littéralement les marchés clandestins moyen-orientaux depuis quelques années ? À Beyrouth, un prince saoudien s’est fait prendre en octobre 2015 avec, excusez du peu, deux tonnes de Captagon® ! Il s’apprêtait à prendre l’avion pour son beau pays. Et l’Arabie saoudite vient d’annoncer une prise de cinq millions de pilules d’amphétamines (lepoint.fr, 27/12/15), avec peine de mort à la clé pour les trafiquants. D’après les chiffres de l’Organisation mondiale des douanes, la quantité de pilules saisies dans les pays de la péninsule arabique a fortement augmenté ces dernières années : plus de 11 tonnes de Captagon® en 2013, contre 4 seulement en 2012 (Sciences et Avenir du 17/11/15).