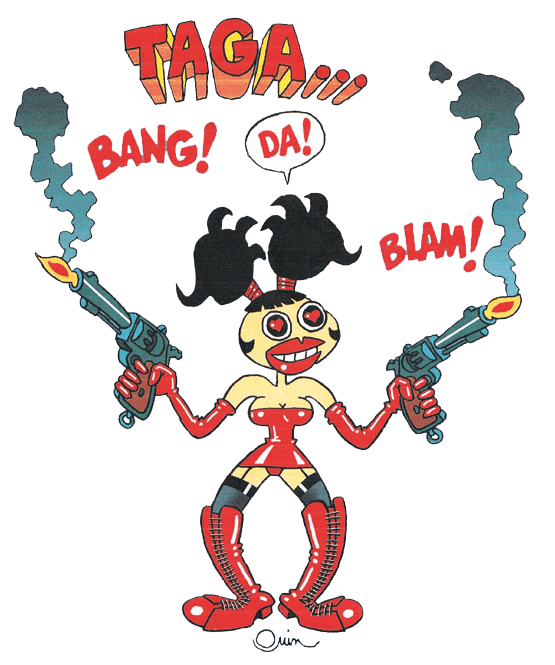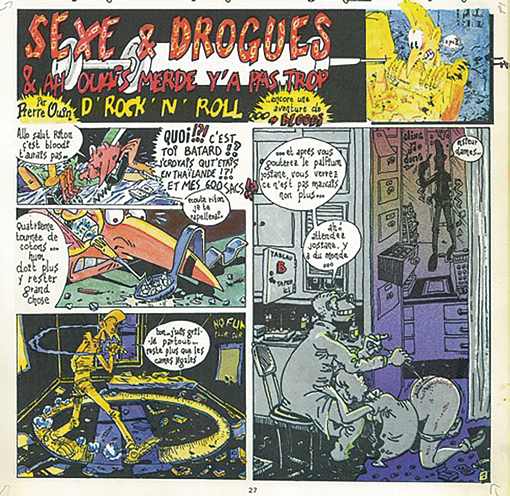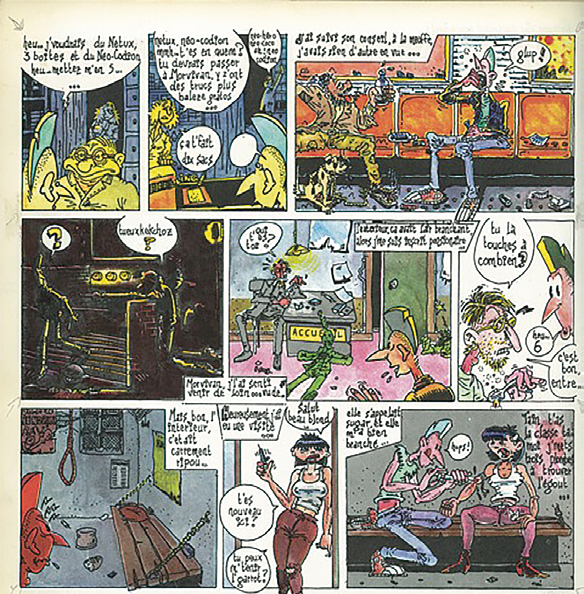L’augmentation des risques
Depuis 2003, on n’a cessé d’entendre que le cannabis rendait dépendant, fou, stérile et impuissant et qu’il tuait sur la route. Que s’est-il passé ? Jusqu’en 2002, on a pu croire que la politique des drogues allait évoluer dans le bon sens mais à l’évidence, la justification médicale n’était qu’un cache-sexe : la guerre à la drogue s’est poursuivie et les usagers de cannabis ont payé le prix fort de la répression.
Les Français ont acquis une expérience collective des effets du cannabis. Les adultes ont pu constater que les jeunes pouvaient dériver avec la fumette, attestant que les usages durs de cette drogue étaient possibles. Autre expérience assez banale : se sentir mal sous cannabis. Expérience intime dont on ne fait pas état. Assez déstabilisante pour rendre crédible l’idée que « le cannabis peut rendre fou ».
Le cannabis qui rend fou
La prévention officielle ne dit pas grand chose de la modification variable des états de conscience sous cannabis. Par exemple, elle passe sous silence les hallucinations provoquées par le haschich lorsqu’il est mangé. Je me souviens avoir entendu un des experts de la Mildt me confier : « Le cannabis, ça ne fait pas grand-chose, j’en ai moi-même consommé, ça peut faire rigoler – sauf pour les fous : ça peut déclencher une psychose ! ». Voilà précisément ce qui ne manque pas d’inquiéter toute personne inexpérimentée brusquement confrontée à ses angoisses : « Je suis tout seul, personne ne m’aime, et en plus, le sol tremble sous mes pieds ! Je dois être fou ! » La menace de la maladie mentale a démultiplié le nombre de consultations, comme l’avait déjà constaté Thomas Szasz(1) au temps des campagnes diabolisantes de la marijuana aux États-Unis.
Les usagers expérimentés apprennent à gérer ces modifications des états de conscience, et dans les milieux festifs, ils savent que face à un « bad trip », il faut rassurer. Exactement le contraire de la prévention qui ne manque pas de menacer « les personnes fragiles » de décompensations psychiatriques, ignorant que ceux qui souffrent de troubles psy sont de plus en plus nombreux à faire une utilisation thérapeutique du cannabis.
Tous dépendants…
Autre expérience collective, avec vingt ou trente ans de consommation régulière, des usagers de cannabis ont pris conscience qu’ils pouvaient difficilement s’en passer. Ils étaient donc devenus « dépendants ». Justement, à la même période, les neurosciences avaient fait irruption dans le champ de la toxicomanie, devenu le champ des addictions : on savait désormais que les mêmes neurotransmetteurs sont sollicités pour tous « les comportements addictifs », avec ou sans drogues. Il n’y avait donc plus à discuter, la dépendance était devenue un fait scientifique, et la dépendance, dans une société qui prêche l’autonomie, c’est mal vu. Reste à savoir ce que recouvre le mot « dépendance » : avec l’addictologie, toutes les dépendances ont été mises dans le même sac, avec ou sans produit. En 1999, un professeur de pharmacie dans lequel j’avais toute confiance m’avait assurée que d’ici trois ans, il y aurait un médicament à même de traiter toutes les dépendances. Voilà qui m’a déstabilisée de prime abord, car même si tous « les comportements addictifs » ont des caractéristiques communes, à l’expérience, le vécu de la dépendance est très différent selon qu’il s’agisse d’héroïne, d’alcool ou de cannabis, une dépendance que pour ma part je considère beaucoup plus proche de la dépendance au chocolat ou au café. Bref, pour l’usager, toutes les addictions n’ont pas les mêmes effets, et en plus, elles ne relèvent pas des mêmes politiques publiques. Mais avec l’addictologie, la question de la politique des drogues a été évacuée dans le champ de la santé, que les drogues soient licites ou illicites, elles relevaient désormais des mêmes traitements.
Tous réprimés !
Il n’en a pas été de même dans le champ de la répression, bien au contraire! Jusqu’en 2002, les autorités affirmaient qu’il n’y avait pas d’usager de drogue en prison, ce qui devait rassurer la partie de l’opinion hostile à l’incarcération. Mais à partir de 2003, le soi-disant laxisme des magistrats a été dénoncé, toutes les infractions devaient être systématiquement sanctionnées. C’est la logique de la tolérance zéro. En 2008, cette politique de tolérance zéro a été adaptée à l’usage, avec un renforcement des sanctions justifié par le raisonnement suivant : les trafiquants se remplacent les uns les autres tant qu’il y aura une demande, c’est donc la demande qu’il faut sanctionner ! C’est la logique de la guerre à la drogue, qui est très explicitement une guerre aux usagers.
Ce qui n’a pas été dit dans le débat français, c’est qu’aux USA, cette politique de tolérance zéro a abouti à une catastrophe sociale et politique avec quelque 45 millions d’incarcérations pour drogue, dont 90 % de Blacks. Il s’agit donc bel et bien d’une guerre « raciale » ou plus précisément « racisée », ce qui en France fait l’objet d’un puisant tabou(2).
« Derrière l’écran de fumée, une guerre sociale » (Politis)
Voilà qui réduit au silence les habitants de ces quartiers, leurs représentants politiques ou les associations. Et pourtant, nous avons appris avec Act Up que « silence = mort ». Alors oui, il est grand temps de dénoncer les mensonges qui alimentent cette guerre meurtrière :
- Non, la répression ne se consacre pas à la lutte contre le trafic, qui représente seulement 7 % des sanctions pénales, une proportion qui n’a cessé de baisser depuis le début des années 1990, alors à près de 30 % des interpellations(3).
- Oui, il y a bien environ 3 500 usagers incarcérés pour usage «simple» (sans détenir de produit), auxquels il faut ajouter quelque quatre mille usagers incarcérés pour détention-acquisition, passibles de dix ans de prison, quelle que soit la quantité.
- Non, la répression des usagers ne limite pas la consommation, mais elle en augmente les risques.
- Non, les interpellations des usagers ne permettent pas de remonter les filières, et ne permettent pas de calmer le jeu, bien au contraire, elles exaspèrent la violence, les règlements de compte et le fossé entre la police et la communauté des habitants.
- Oui, les usagers « noirs ou arabes » sont les premières victimes de la répression, alors même que les jeunes « Blancs » des classes moyennes consomment plus de cannabis.
Un pognon de dingue
À quoi sert cette répression massive ? La réponse est devenue évidente avec le débat parlementaire sur la contraventionnalisation : seuls les services répressifs ont été sollicités, les professionnels de santé n’ayant même pas été invités. La lutte contre « La drogue » est devenue un outil de contrôle policier des cités. « Derrière l’écran de fumée, une guerre sociale », titre ainsi le dossier Drogues du journal Politis, au détriment de la santé publique, précise le journal(4).
Le premier des risques liés à l’usage de cannabis est bien la répression. L’Organisation mondiale de la santé et celle des Nations unies l’ont dit clairement en 2016 : la guerre à la drogue est un échec, il faut y mettre fin. C’est ce qui est en train de se passer aujourd’hui, d’abord avec le cannabis thérapeutique, et plus encore avec la légalisation du cannabis en cours dans des États de plus en plus nombreux. Un Français sur deux est désormais favorable à une autorisation régulée du cannabis, alors même que la contraventionnalisation s’ajoute au dispositif répressif. Il y a pourtant urgence à changer : la guerre à la drogue coûte un pognon de dingue, près d’un milliard par an, selon Pierre Kopp. Et les coûts sociaux sont plus élevés encore, avec l’exaspération de la violence, des vies brisées et des violations des droits humains, une question au cœur des débats internationaux mais qui reste un tabou de la société française. L’État de Washington vient de gracier 3 500 usagers de cannabis. Combien de temps faudra-t-il attendre pour l’État français fasse à son tour amende honorable ?
Anne Coppel
- La persécution rituelle des drogués, Thomas Szasz, Éditions du Lézard
- https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070515/
- Voir « La politique du chiffre », p. 2.
- https://www.politis.fr/dossiers/drogues-pourquoi-ca-coince-enfrance-
427/