L’empire du classement
Et si la réalité des drogues ne tenait qu’à l’acte de classer, dont Perec(1) et Foucault(2) ont souligné la dimension fondatrice dans l’exercice de la pensée humaine ? Il y aurait une histoire comparée à faire en observant la manière dont chaque culture a classé les différents psychotropes, les a organisés entre eux, dans un jeu d’oppositions et de distinctions fonctionnelles : thérapeutique, dopant, enthéogène, etc. Je classe donc je suis : c’est la fonction du classement de faire exister les drogues, une lapalissade moins évidente qu’elle en a l’air.
Ces catégorisations ont évolué dans le temps et dans l’espace, au gré des sociétés, mais elles ont fini par se sédimenter, à travers des conventions internationales, majoritairement pour définir le statut juridique des différents produits. C’est cette opération de catégorisation qui fonde essentiellement les logiques prohibitives qui classent un certain nombre de produits comme des « drogues » et les constituent en listes de substances interdites. À ce titre, elle rend possible la distinction entre le licite et l’illicite, qui fait peu de cas des finalités liées aux usages pour mettre toute une série de substances dans le même sac, sur la base d’une dangerosité et d’un péril supposés : l’addiction.
Des critères nécessaires mais pas suffisants
Cette catégorie « drogues » s’est révélée n’être ni vraiment complète ni vraiment cohérente et le discours antiprohibitionniste, appuyé sur la science, a depuis longtemps montré toute la part d’arbitraire qui présidait à ce classement, en reconnaissant le caractère construit de cette opération, pour la déconstruire ou au moins la dénaturaliser (pourquoi le cannabis et pas le tabac ?). Cette classe se définit aussi parce qu’elle s’oppose à la fois à la classe des médicaments d’une part, au prescrit donc, et, d’autre part, à ce qui n’est pas interdit, comme l’alcool par exemple. On notera d’ailleurs qu’il n’y a pas de nom générique pour désigner la classe des psychotropes autorisés, sauf à parler, comme depuis peu et de manière polémique, de « drogues licites ».
On pourrait résumer l’histoire de l’addictologie moderne au fait d’avoir rompu ces distinctions, d’avoir constitué une vaste classe de tous les produits psychotropes (hors les médicaments qui n’intègrent cette classe que par le mésusage), une hyper classe qui englobe l’alcool, le tabac et les autres drogues. Le rapport Roques(3), en rapprochant certaines substances, certaines licites et d’autres pas, sur des bases scientifiques, celles de la dangerosité, provoqua bien des remous. Aujourd’hui, il est en effet admis par la communauté scientifique que le tabac ou l’alcool relève du même paradigme que l’héroïne ou le cannabis et que la frontière de l’interdit a un sens juridique, moral, social, mais beaucoup moins de sens au regard de la seule science ou de la médecine.
Il faut sans doute commencer par interroger la catégorie « drogues» en intention, selon les critères qu’elle convoque. La classe est constituée autour de la dimension addictogène des produits, des risques à court ou long terme qu’ils font courir à l’organisme. Ces critères sont nécessaires, mais pas suffisants. Le fait que ces produits soient étrangers à la culture est un facteur aggravant, comme on l’a régulièrement constaté dans l’histoire des prohibitions avec l’opium asiatique, le cannabis africain ou la coca amérindienne. De plus, cette frontière entre le licite et l’illicite n’est pas la seule en cause. Évidemment, cette catégorisation varie énormément dans les représentations qu’elle suscite. Au sein même de la classe des «drogues», on note la présence de produits plus prototypiques(4) que d’autres. L’héroïne injectée naguère ou le crack aujourd’hui sont les produits par excellence qui incarnent cette classe et ceux qui les utilisent sont les figures
mêmes du « drogué ». Le couple cocaïne/crack est intéressant de ce point de vue. Il s’agit de produits très proches l’un de l’autre, en termes d’effets et de risques, même si les modes de c o n s o m m a t i o n standards divergent (inhalation/combustion). Pourtant, les regards portés sur eux diffèrent fortement, la cocaïne conservant longtemps une image « chic » et moins nocive alors que le crack a été immédiatement associé à la rue et aux usages les plus nocifs. Cette distinction de surface renforce des oppositions sociales (drogues de riche, drogue de pauvre) ou raciales (drogues de Blanc, drogue de Noir), même s’il existe sans doute des usagers occasionnels de crack et des injecteurs compulsifs de cocaïne.
La « décatégorisation » du cannabis
Cependant, cette vaste opération de catégorisation n’est pas entièrement statique. Elle évolue dans le temps, les individus lui appartenant peuvent être déplacés, inclus ou exclus, dans les représentations sociales ou dans les lois. C’est cette dimension dynamique qui est intéressante à observer.
On assiste par exemple aujourd’hui à une lente évolution du cannabis, qui passe peu à peu de la catégorie « drogue » à autre chose. Il faut noter une étape importante dans cette évolution, qui apparaît presque comme un réquisit : le passage par la case « médicament », puisqu’on l’a vu, dans les différents pays où la législation a changé, cela a été précédé et sans doute rendu possible par le fait d’admettre les bienfaits thérapeutiques du cannabis. Comme si cette dimension médicale valait purgatoire pour ce psychotrope, passage obligé avant d’être admis comme une marchandise à consommer comme une autre. Cette opération de « décatégorisation » a nécessité un plaidoyer, un lobbying, des prises de positions politiques, une évolution de mœurs, mais aussi une évolution cognitive qui le fait passer du produit prohibé (négation des bénéfices et majoration des risques) au médicament (arbitrage assumé entre risques et bénéfices) puis au produit accepté (minoration des risques et valorisation des bienfaits). Considérer sous l’angle cognitif les opérations qui conduisent à l’interdit ou à l’assouplissement de la loi concernant les psychotropes nous renseigne sur la façon même de constituer ces catégories. Les débats récents qui distinguent désormais au sein de la même plante, des principes actifs et des molécules différentes, le THC et le CBD, reproduisent ce type d’opérations. D’un côté, la molécule psychoactive qui fait planer, de l’autre, celle qu’on associe plus volontiers à une fonction médicale, antalgique, anxiolytique, anti-inflammatoire, etc. Cette distinction, qui relève ici de la chimie, change le regard que nous portons sur le produit, l’inclinant vers le médicament et ce faisant, le rendant acceptable, dans un paradigme qui propose de soulager des dysfonctionnements organiques vs de créer des altérations dans le fonctionnement de l’esprit. Le trajet du cannabis : drogue‑ > médicament – > psychotrope légal fait bien apparaître le médicament comme étape presque obligée, dans le passage d’une catégorie à une autre.
Tabac et alcool sur d’autres voies
Le tabac est d’une certaine façon en train de parcourir le chemin inverse. En vingt ou trente ans, il est passé d’un produit standard accepté de tous et même extraordinairement valorisant symboliquement à une sorte de drogue encore légale, donnant lieu à un fort jugement moral et dévalorisée socialement, tant le consensus est fort à la fois sur sa dangerosité, liée à la combustion, et son caractère addictogène, propre à la nicotine. En solutionnant la question de la combustion, le vapotage se construit d’abord comme une forme de substitution à la tabagie, entrant ainsi, au moins dans un premier temps, dans le paradigme médical et renforçant encore le statut de « drogue » du tabac. Cette lente construction du tabac comme une drogue à partir des années 1970, contre l’industrie qui en vivait, est due essentiellement à des politiques publiques volontaristes largement motivées par la causalité cancérigène et la morbidité très importante qu’elle entraîne. L’évolution de l’usage est ici passée par la lutte contre le premier contact avec le produit, pour le limiter ou le retarder, par le renforcement du choix de l’abstinence, ou par une modification du mode de consommation avec le vapotage. On notera qu’on a assez peu là encore réfléchi à l’effet psychotrope lui-même, à la fonction de la nicotine dans le cerveau, à quel besoin exact correspond l’envie de fumer une cigarette.
L’alcool, peut-être le psychotrope le plus ancien de l’humanité, est inscrit lui aussi dans une histoire changeante. Strictement interdit dans le monde musulman et situé au cœur de la culture occidentale liée au vin, il a connu aussi ponctuellement un changement de catégories avec, bien sûr, la prohibition aux États-Unis, parfait exemple d’un changement de statut sur lequel on a fini par revenir. Ce statut très ambivalent, qui n’existe que pour
lui, fait qu’il est mal vu de ne pas boire ici, et qu’il l’est tout autant de boire là. Aujourd’hui, les débats entre addictologues d’une part et les producteurs et industriel ou l’État d’autre part, se font sur des enjeux de catégorisation. Le débat actuel sur le vin, qui oppose l’addictologie à la filière, est un bon exemple de ces enjeux de catégorisation. Le vin, surtout mis en avant pour ses dimensions organoleptiques, pour le savoir-faire dont il procède, pour la culture dans laquelle il s’inscrit, est minoré comme produit addictogène et les régulations dont il fait l’objet sont discutées. Les représentations liées au patrimoine, à la culture, à la convivialité s’opposent ainsi à celles qui sont liées à l’addiction, à l’alcoolisme, aux risques pour la santé liée à l’alcool, y compris sous forme de vin. On retrouve, de manière très différente, les distinctions opérées dans les représentations entre cocaïne et crack. Le produit, parce qu’il est consommé, donne lieu à euphémisation de son risque, et c’est l’inverse qui se produit quand le produit est au contraire interdit.
« Drogues » vs « médicaments »
La distinction « drogues »/« médicaments » est bien sûr centrale et vieille comme la philosophie et le pharmakon platonicien. Le prescrit et le proscrit ont toujours flirté et la frontière est étroite entre les substances interdites par la science médicale (et la loi), et celle dont elle s’assure le monopole. L’usage le plus massif de psychotropes est sans doute celui des médicaments du même nom, à égalité avec celui d’alcool, pour l’usage régulier comme pour l’usage occasionnel5. La prescription, le dialogue avec le médecin, le cadre thérapeutique, les garanties sur les produits, leur dosage, leurs effets, créent un cadre d’acceptabilité pour des effets psychotropes (antidépresseurs, thymorégulateurs, anxiolytiques, hypnotiques) qui ne sont parfois pas très éloignés de ceux qui peuvent être recherchés à travers un usage illicite. Il ne s’agit ici ni de conspuer l’usage excessif de médicaments psychotropes ni de justifier l’usage des « drogues » par l’automédication, mais de montrer les ponts qu’il existe entre ces univers pourtant construits comme antagonistes.
La crise dite « des opioïdes » qui a aujourd’hui cours outre-Atlantique, a fait voler ces frontières en éclats. On sait comment les laboratoires ont poussé à la consommation d’antalgiques puissants un très grand nombre de patients, souvent en souffrance sociale, pour finir par les lâcher dans les rues et sur le Web en quête de fentanyl qui pourrait remplacer ce qui avait été initialement prescrit. L’éthique médicale est ici bousculée par les intérêts industriels des grands laboratoires.
La substitution est un autre exemple de la question de la catégorisation. Ou comment, face à l’apparition de drogues et surtout du sida, on met en place, on invente, en quelque sorte, des médicaments de substitution comme la méthadone ou du moins on les construit. Par le cadre de la prescription, bien sûr, par la sélection de quelques propriétés distinctes du produit à substituer – pas de « high » par exemple –, et comment on en assume le caractère addictogène et des effets secondaires non négligeables, au profit d’une stabilisation du patient et d’une meilleure insertion sociale. Il ne s’agit en rien de remettre en cause l’utilité de ces approches, le bienfait qu’elles peuvent constituer à un moment dans un parcours. Mais outre que la compliance n’est pas la règle, que la substitution s’accompagne aussi du mésusage, il faut s’interroger sur des traitements qui sont appelés à s’installer dans la chronicité, et à reconduire (pour toujours ?) le sentiment de dépendance éprouvé. Via ces stratégies de substitution, on voit d’ailleurs lentement s’opérer un déplacement de l’opposition licite vs illicite vers la distinction entre drogues et médicaments.
Ce travail de catégorisation a bien sûr son pendant du côté des usagers et des usages, acceptés ou stigmatisés, selon les substances consommées.
Pourtant, cette classification ne rend pas justice à la variété des sujets et des contextes et c’est seulement en remettant en cause non pas seulement des lois, mais une épistémè6, définie comme système de catégorisation, qu’on pourra faire évoluer les représentations et les frontières normatives afin de pouvoir proposer des régulations effectives.
Jean-Maxence Granier
- Penser/Classer, Georges Perec, Paris, 1985.
- L’archéologie du savoir, Michel Foucault, Paris, 1969.
- Rapport Roques.
- Sémantique du prototype : qui ne définit pas une classe par son intention (définition) ou son extension (les individus de la classe), mais par des relations de plus ou moins grande ressemblance avec un individu « prototypique ».
- Voir chiffres OFDT.
- C’est-à-dire, selon Foucault, la manière même d’organiser le savoir à travers une vision du monde pour un groupe social donné ou une période donnée



 De plus, l’abstinence peut paraître s’inscrire dans un paradigme moral et ascétique, entre tentation et repentance. Le terme lui-même se retrouve par exemple dans les prescriptions religieuses touchant à la sexualité et est encore parfois dans ce domaine présenté comme la meilleure façon de se prémunir du sida, faisant fi des êtres humains et de leur réalité. Cette dimension judéo-chrétienne peut encore être renforcée, en apparence, par la dimension spirituelle (plutôt que religieuse) de certains de ces groupes d’autosupport. Enfin, elle peut être aussi associée elle-même à une forme d’excès puisqu’elle s’étend souvent à tous les psychotropes, interdits ou non, et apparaître alors comme une autre forme d’addiction, s’opposant alors à la consommation modérée.
De plus, l’abstinence peut paraître s’inscrire dans un paradigme moral et ascétique, entre tentation et repentance. Le terme lui-même se retrouve par exemple dans les prescriptions religieuses touchant à la sexualité et est encore parfois dans ce domaine présenté comme la meilleure façon de se prémunir du sida, faisant fi des êtres humains et de leur réalité. Cette dimension judéo-chrétienne peut encore être renforcée, en apparence, par la dimension spirituelle (plutôt que religieuse) de certains de ces groupes d’autosupport. Enfin, elle peut être aussi associée elle-même à une forme d’excès puisqu’elle s’étend souvent à tous les psychotropes, interdits ou non, et apparaître alors comme une autre forme d’addiction, s’opposant alors à la consommation modérée. L’abstinence n’épouse pas obligatoirement la logique de prohibition. Elle n’appartient pas aux prohibitionnistes qui l’ont arrimée à leur doctrine et en ont l’usufruit plus que la nue-propriété. De nombreux éléments d’analyse montrent que le lien qui associe prohibition (comme interdit) et abstinence (comme choix et non comme injonction) n’est en rien essentiel. À l’heure où la frontière entre l’autorisé et le prohibé, dans les produits comme dans les soins, est de moins en moins probante, on se propose de déconstruire cet antagonisme en partie fictif et surtout dangereux, en montrant à la fois comment l’abstinence a vocation à s’inscrire de plein droit dans une logique de RdR et comment la RdR peut s’enrichir de cet apport, face par exemple à la question de la sortie des TSO.
L’abstinence n’épouse pas obligatoirement la logique de prohibition. Elle n’appartient pas aux prohibitionnistes qui l’ont arrimée à leur doctrine et en ont l’usufruit plus que la nue-propriété. De nombreux éléments d’analyse montrent que le lien qui associe prohibition (comme interdit) et abstinence (comme choix et non comme injonction) n’est en rien essentiel. À l’heure où la frontière entre l’autorisé et le prohibé, dans les produits comme dans les soins, est de moins en moins probante, on se propose de déconstruire cet antagonisme en partie fictif et surtout dangereux, en montrant à la fois comment l’abstinence a vocation à s’inscrire de plein droit dans une logique de RdR et comment la RdR peut s’enrichir de cet apport, face par exemple à la question de la sortie des TSO.
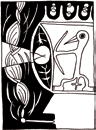 Pas plus qu’elle ne s’oppose à la RdR, l’abstinence ne se confond donc avec la prohibition. Elle apparaît, au contraire, comme sa continuation par d’autres moyens. Encore faut-il être vivant pour pouvoir faire le choix de l’abstinence : tout ce qui protège l’usager des risques (mais non de l’addiction elle-même) s’impose à l’évidence. La RdR et l’abstinence sont donc moins dans un rapport d’opposition que dans un rapport d’articulation. Elles doivent à ce titre, en sortant des oppositions stériles, s’inscrire dans une seule panoplie d’offres, qui assumerait l’une comme une voie possible dans le champ de l’autre.
Pas plus qu’elle ne s’oppose à la RdR, l’abstinence ne se confond donc avec la prohibition. Elle apparaît, au contraire, comme sa continuation par d’autres moyens. Encore faut-il être vivant pour pouvoir faire le choix de l’abstinence : tout ce qui protège l’usager des risques (mais non de l’addiction elle-même) s’impose à l’évidence. La RdR et l’abstinence sont donc moins dans un rapport d’opposition que dans un rapport d’articulation. Elles doivent à ce titre, en sortant des oppositions stériles, s’inscrire dans une seule panoplie d’offres, qui assumerait l’une comme une voie possible dans le champ de l’autre. En parallèle, la question de l’abstinence vient réinterroger la RdR et l’oblige à se repenser sur plusieurs plans. D’abord, sur celui de la définition même de l’usager : est-il celui qui prend plaisir et qui contrôle ou celui qui souffre de sa dépendance, celui de l’usage, de l’abus, de l’assuétude ? Se dessine alors un usager de produits psychotropes qui, comme personne, subsume ce statut et peut envisager la continuité de son usage mais aussi sa fin, en rejetant l’assignation à sa toxicomanie.
En parallèle, la question de l’abstinence vient réinterroger la RdR et l’oblige à se repenser sur plusieurs plans. D’abord, sur celui de la définition même de l’usager : est-il celui qui prend plaisir et qui contrôle ou celui qui souffre de sa dépendance, celui de l’usage, de l’abus, de l’assuétude ? Se dessine alors un usager de produits psychotropes qui, comme personne, subsume ce statut et peut envisager la continuité de son usage mais aussi sa fin, en rejetant l’assignation à sa toxicomanie.
