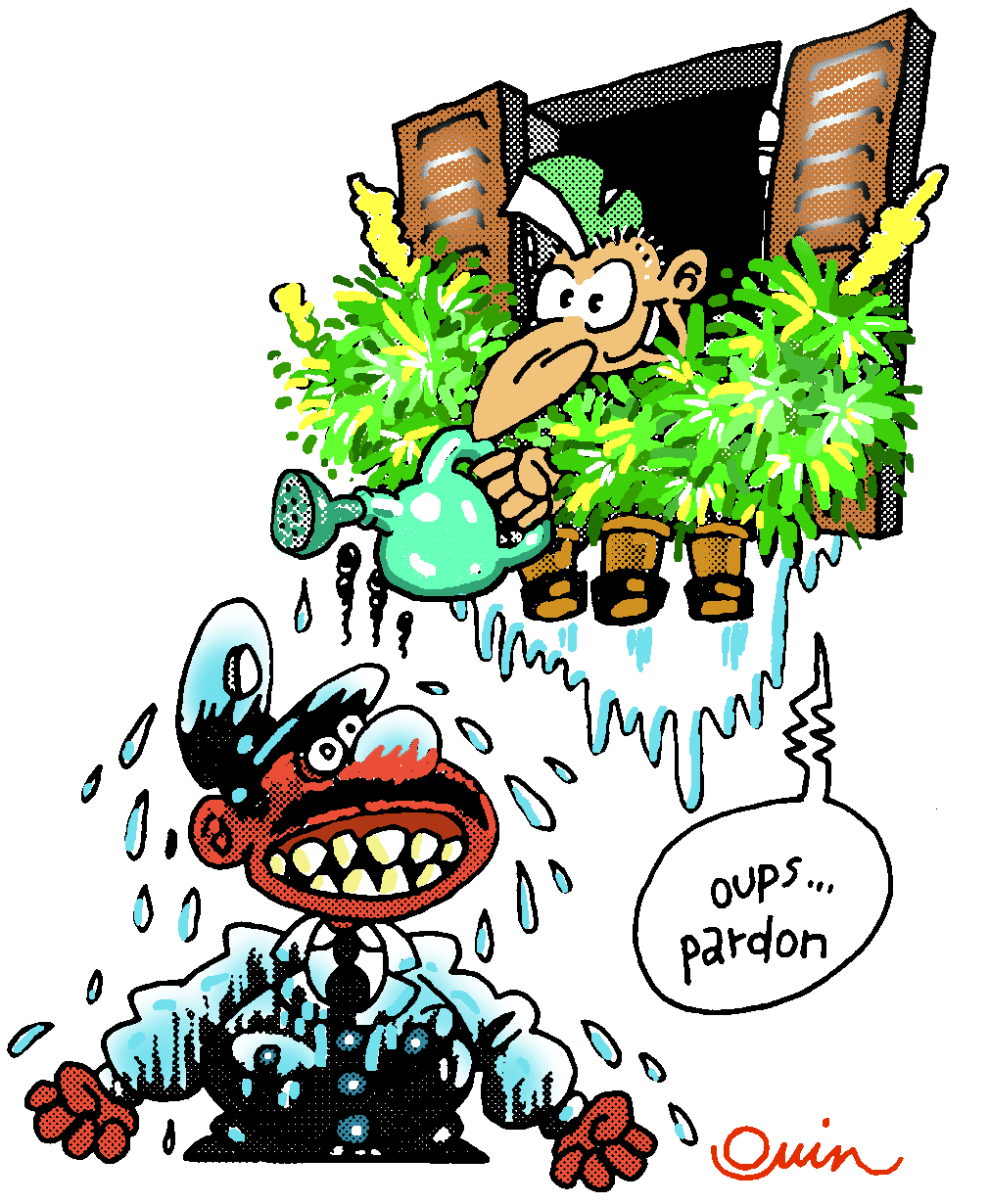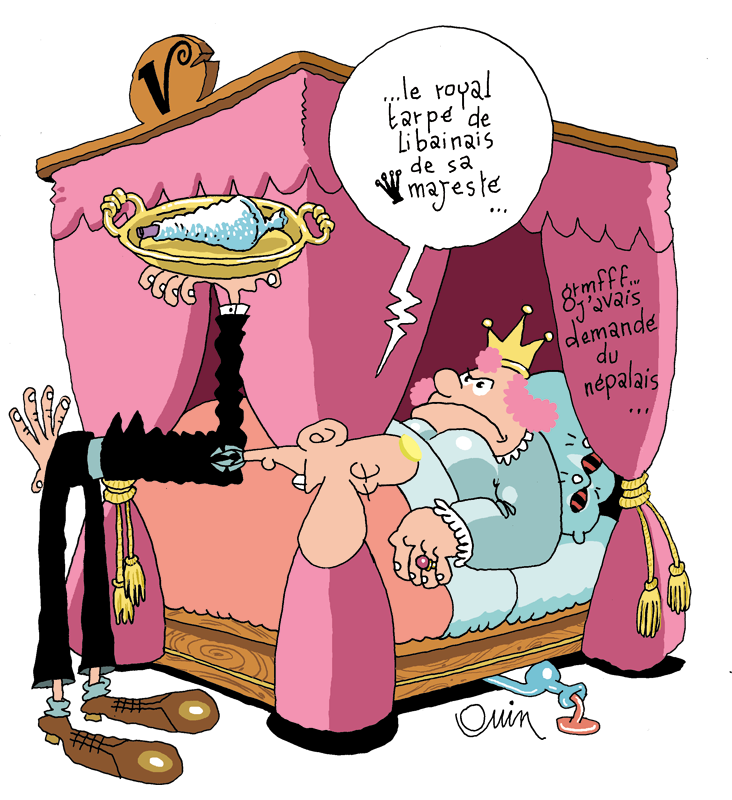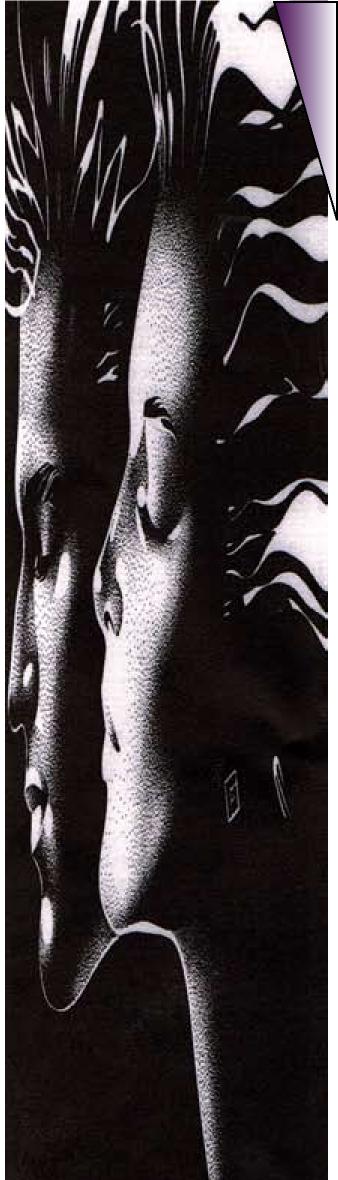Ces mensonges qui nous font tant de mal
Juin 2010, les discours de Pétain passent en boucle sur les radios. Un des fleurons de cette rhétorique pleurnicharde est le discours du 17 juin 1940 sur « ces mensonges qui nous ont fait tant de mal », une phrase qui s’applique parfaitement au débat sur les politiques de drogues au niveau international et leur présentation par les officiels français : une succession de contrevérités énoncées puis répétées de manière systématique, quel que soit le contexte.
 L’escroquerie est de laisser croire que notre politique des drogues – à l’image de notre football – pourrait prétendre à un podium mondial. Une distorsion impudente de la réalité qui devrait normalement nous conduire à changer d’entraineur ces prochaines années.
L’escroquerie est de laisser croire que notre politique des drogues – à l’image de notre football – pourrait prétendre à un podium mondial. Une distorsion impudente de la réalité qui devrait normalement nous conduire à changer d’entraineur ces prochaines années.
Propagande
Premier mensonge : « La consommation de cannabis baisse grâce à l’intensification de la répression. » N’importe quel statisticien débutant peut aisément prouver que sur le court terme, c’est-àdire à l’échelle de quinze ou vingt ans, la consommation de cannabis a progressé jusqu’à atteindre des niveaux qui nous placent en tête des pays de l’Union européenne alors que parallèlement, les interpellations n’ont cessé d’augmenter. Tous les gens sérieux estiment que les liens de cause à effet entre répression et consommation de drogues sont impossibles à corréler scientifiquement. Soumis à des régimes législatifs très différents, les États-Unis, l’Espagne ou le Royaume-Uni caracolent au top du hit-parade de la fumette mondiale. À l’inverse, la Suède et les Pays-Bas, dont les politiques sont absolument antithétiques, affichent des scores très modérés. Les incidences culturelles, le rôle de l’environnement social, l’appréciation collective de l’ivresse, la place de la sexualité, toutes ces questions qui mériteraient au contraire d’être observées minutieusement sont toujours traitées par le mépris, voire complètement ignorées par le discours de propagande politiquement correcte sur le fléau de la drogue.
Quelques milliers de Français fumaient de la « marijuana » en 1970, lorsque la loi du même nom fut votée.
Depuis, les arrestations et les emprisonnements pour usage, possession, détention et autres ont progressé de manière exponentielle, et les milliers sont devenus millions. La courbe a culminé en 2005, avec 5 millions d’individus ayant déclaré avoir fumé du cannabis dans l’année écoulée. Ce n’est que tout dernièrement, entre 2005 et 2010, qu’une baisse impressionnante de 0,5% par an du nombre de consommateurs a permis un élan de triomphalisme cocardier : la consommation de cannabis baisse, et c’est évidemment grâce au renforcement de la répression !
Désinformation
Autre mensonge éhonté : « Les pays européens qui ont assoupli leur législation sur les drogues sont en train de revenir en arrière. » Là, il ne s’agit plus d’approximations sur les chiffres mais de pure désinformation. Les exemples cités sont toujours les mêmes : l’Espagne et les Pays-Bas, les 2 finalistes de la coupe du monde (tiens, tiens !).
Commençons par nos voisins les Ibères. Après avoir minutieusement démantelé la législation franquiste, le royaume espagnol est effectivement revenu en arrière… en 1986, il y a vingt-quatre ans ! S’il a alors supprimé la possibilité de consommer en public (flash-back sur les injecteurs d’héroïne juchés sur les monuments historiques), aucun pouvoir – fut-il néofranquiste, comme celui du Parti Populaire d’Aznar – n’a jamais recriminalisé l’usage simple et privé. Il suffit de se balader n’importe où dans la péninsule pour le comprendre.
Tous les gens sérieux estiment que les liens de cause à effet entre répression et consommation de drogues sont impossibles à corréler scientifiquement Décisionnaires en matière de drogues, les régions autonomes ne cessent, au contraire, d’approfondir depuis dix ans une politique de réduction des risques audacieuse qui associe salles de consommations et programmes d’héroïne médicalisés. Autant de choses qui hérissent le poil de nos supporters hystériques du modèle français. Plutôt que de parler du retour en arrière, on ferait mieux de les suivre dans la surface de réparation (ha mais !)
Parlons maintenant de l’autre finaliste, la Hollande. « Les Pays-Bas reviennent sur leur modèle de prise en charge », nous dit-on. Quelle farce ! Certes, le débat sur les coffee shops occupe une place prépondérante dans les joutes politiciennes, mais que reproche-t-on exactement à ces oasis de tolérance cannabique ? L’afflux de Français (entre autres). Soi-disant décrié, le modèle hollandais a en effet permis au consommateur de cannabis local de trouver seul des raisons de fumer ou de ne pas fumer, sans être parasité par l’imbroglio psychologique de l’interdit. Le nombre de fumeurs étant proportionnellement plus faible aux Pays-Bas qu’en France, le plus étonnant est que nos voisins bataves aient trouvé sur ces bases plus de raisons de s’abstenir que de planer avec de l’herbe-quifait-rire-bêtement. Ce qui défrise le Hollandais moyen, ce sont les hordes de fumeurs étrangers, et tout particulièrement français, qui écument les coffee shops le temps d’un week-end, par ailleurs copieusement arrosé de bière. Cette fonction d’oasis cannabique dans le désert européen finit par lasser une partie de l’opinion hollandaise, qui songe à réserver l’endroit aux seuls Bataves de souche. On a l’identité nationale qu’on peut…
Et mensonge par omission
Le dernier mensonge est un mensonge par omission. Dans le continuum du mensonge n°2 qui veut que la tendance européenne soit au renforcement de l’interdit, les officiels français se gardent bien d’évoquer le nombre croissant de pays européens qui dépénalisent. Non seulement l’Espagne et les Pays-Bas ne reviennent pas en arrière, mais le Portugal en 2004 et plus récemment la Tchéquie en 2009 ont décidé de dépénaliser l’usage de drogues. Essentiellement prise pour des raisons sanitaires, la décision portugaise a fait l’objet de tellement de commentaires internationaux que les partisans américains d’une réforme des politiques de drogues évoquent couramment le « modèle portugais » comme référence européenne, une sorte de propédeutique de dépénalisation. Une définition qui n’a évidemment pas de sens en France puisque notre politique est un succès total.
Pour clore l’affaire, mentionnons quelques statistiques incontournables sur le sujet. Selon l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies, la France décroche la médaille de bronze du championnat des amateurs de bédos, avec 30,6% de fumeurs de cannabis chez les 15-64 ans. Sur les 27 pays engagés dans la compétition, nos athlètes se placent juste derrière les Danois et les Italiens mais coiffent d’une courte tête l’Angleterre, qui vit surtout sur sa réputation. Des chiffres dont notre « Drug Czar », Monsieur Apaire, se soucie comme d’une guigne. Interrogé le 10 août dernier par le journal Le Monde sur les salles de consommations à moindres risques, il récidive en déclarant : « En France, la consommation de drogue a globalement baissé, celle d’héroïne y est moins importante qu’ailleurs en Europe. Le nombre d’overdoses y est aussi l’un des plus faibles. » Cette déclaration, très « Mundial 2010 », nous rappelle que la déformation systématique de la réalité peut ressembler à une forme d’addiction. Au-delà d’un certain seuil, on ne peut plus s’arrêter. La cocaïne bat des records historiques, l’héroïne relève la tête, le cannabis fait de nous les vainqueurs de la petite finale… et notre politique est la meilleure du monde.
Juin 1940-juillet 2010 : en France, la « gagne » est une valeur nationale reconnue. Alors pour les drogues, surtout ne changeons rien.














 À quel moment t’es-tu rendu compte que ta pharmacie était plus volontiers que d’autres visitée par des clients un peu « space » ?
À quel moment t’es-tu rendu compte que ta pharmacie était plus volontiers que d’autres visitée par des clients un peu « space » ? Certainement, mais il y a des choix à faire. Tout dépend du nombre d’ordonnances que l’on voit passer par jour. Si la mamie qui vient chercher ses Valda 2 fois par semaine se cogne systématiquement à un gus au look zarbi, elle risque de changer de crèmerie rapidement.
Certainement, mais il y a des choix à faire. Tout dépend du nombre d’ordonnances que l’on voit passer par jour. Si la mamie qui vient chercher ses Valda 2 fois par semaine se cogne systématiquement à un gus au look zarbi, elle risque de changer de crèmerie rapidement. Fermeté, mais humilité. Ne jamais « jeter » la personne, savoir céder s’il le faut, et délivrer l’ordonnance. Il faut savoir lâcher, même un « Ropinol, quat comprimmé par jour pandan 1 moi », prescrit par le Dr Guettotrou, gynéco-obstétricien à Pointe-à-Pitre…
Fermeté, mais humilité. Ne jamais « jeter » la personne, savoir céder s’il le faut, et délivrer l’ordonnance. Il faut savoir lâcher, même un « Ropinol, quat comprimmé par jour pandan 1 moi », prescrit par le Dr Guettotrou, gynéco-obstétricien à Pointe-à-Pitre… J’ai une jolie photo de moi avec 2 yeux au beurre noir qui en témoigne douloureusement. Une ordonnance refusée pour un motif que je trouve maintenant futile (date d’ordo périmée), le type s’énerve vraiment, moi aussi, les flics débarquent, le sortent difficilement, et le laissent partir. La voiture de police reste un petit moment devant l’officine au cas où et… part. Cinq minutes plus tard, le gars revient fou de rage, fait le tour du comptoir et… boum. C’est le métier qui rentre, j’ai tout fait de travers. Une autre fois, un tox rentre dans l’officine, il vient de s’ouvrir les veines du poignet dans un coup de déprime. Ça pisse le sang de partout à gros jets. Je me jette dessus pour faire un point de compression et limiter l’hémorragie en attendant les pompiers. Dans l’urgence, je ne prends pas de précautions, pas de gants, rien. J’ai du sang un peu partout. Rien de grave, mais gros flip quand même.
J’ai une jolie photo de moi avec 2 yeux au beurre noir qui en témoigne douloureusement. Une ordonnance refusée pour un motif que je trouve maintenant futile (date d’ordo périmée), le type s’énerve vraiment, moi aussi, les flics débarquent, le sortent difficilement, et le laissent partir. La voiture de police reste un petit moment devant l’officine au cas où et… part. Cinq minutes plus tard, le gars revient fou de rage, fait le tour du comptoir et… boum. C’est le métier qui rentre, j’ai tout fait de travers. Une autre fois, un tox rentre dans l’officine, il vient de s’ouvrir les veines du poignet dans un coup de déprime. Ça pisse le sang de partout à gros jets. Je me jette dessus pour faire un point de compression et limiter l’hémorragie en attendant les pompiers. Dans l’urgence, je ne prends pas de précautions, pas de gants, rien. J’ai du sang un peu partout. Rien de grave, mais gros flip quand même. Nom d’un pharmacien !
Nom d’un pharmacien !