Audition Publique 2.0 sur la Réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives
Les 7 et 8 avril 2016, la Fédération Française d’Addictologie a organisé une audition publique 2.0, retransmise en direct sur internet, sur la Réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives pour faire le point sur les pratiques professionnelles existantes et sur les enjeux à venir.
15 recommandations pour un changement d’orientation de la politique des drogues en France
- Le développement de la RdRD passe par la dépénalisation de l’usage et donc par la révision de la loi de 1970 qui est en conflit avec la loi de santé publique de 2016. La dépénalisation de l’usage doit s’accompagner d’une réflexion sur la régulation des marchés des produits licites et illicites et sur les mesures à mettre en œuvre.
- Préparer et organiser un débat sociétal, en lien avec les collectivités territoriales, sur les enjeux des addictions et de la stratégie de RdRD.
- Valoriser les expériences existantes des usagers des groupes d’auto-support et des associations d’entraide. Renforcer les capacités des associations d’usagers dans le champ des drogues licites ou illicites afin de pouvoir agir dans un cadre légal et d’avoir des moyens pour s’organiser et être des interlocuteurs des pouvoirs publics.
Ces changements de pratiques doivent être fondés avant tout sur le rôle central des usagers. Valoriser leurs compétences et savoir-faire au travers d’un statut ouvrant à droits et rémunérations.
- La perspective gradualiste suppose la mise en réseau d’acteurs aussi différents que la police, la justice, l’éducation, l’insertion sociale, la santé. Développer des compétences partagées sur les problématiques liées aux usages, sur la philosophie et les outils de la RdRD.
- Les professionnels du soin et de la santé (médecins généralistes et hospitaliers, pharmaciens, psychologues, infirmiers, sages-femmes, travailleurs sociaux, etc.) doivent intégrer la philosophie de la RdRD dans l’ensemble de leurs pratiques y compris au-delà du champ des addictions.
- Rapprocher les CSAPA et CAARUD dans leurs cultures et leurs pratiques, et développer la confiance réciproque.
- Mieux intégrer les usagers dans le fonctionnement (pairs-aidants)
- Mieux intégrer les usagers dans la gouvernance des structures (conseils d’administration et comités de pilotage)
- Ouvrir des espaces de consommation à moindre risque au sein des lieux existants (CAARUD et CSAPA) et mettre en place un dispositif d’analyse des produits consommés après étude des besoins et en respect du cahier des charges national.
- Développer des programmes et des actions de RdRD destinés à des publics peu pris en compte actuellement comme les jeunes, les femmes, des personnes privées de liberté, des migrants, des seniors…
- Dans le domaine du tabagisme, la cigarette électronique est un outil complémentaire de la réduction des risques qui permet à une partie non négligeable de ses utilisateurs de réduire significativement les effets délétères de la combustion du tabac. Cet outil nécessite une nouvelle approche de développement, d’évaluation et de recherche.
- Encourager la recherche académique à travers le développement d’études participatives fondée sur la reconnaissance de savoirs expérientiels des usagers.
- Mise en place d’un organisme indépendant destiné à la gouvernance et au financement des recherches autant académiques que venant du terrain et des usagers sous une forme à élaborer, tenant compte de l’existant.
- Rendre effectivement accessibles les approches et les outils de RdRD dans les lieux de privation de liberté (établissements pénitentiaires et psychiatriques).
- Agir sur la prévention en tenant compte du pouvoir délétère des lobbyings au niveau français et européen en régulant l’accessibilité aux boissons alcoolisées, en encadrant la publicité et en évitant de laisser à l’industrie cigarettière une influence excessive sur la réglementation des produits de remplacement.
- Mieux prendre en compte les familles dans les problématiques générales des usagers, y compris dans les dispositifs de RdRD.
- Analyser et proposer des réponses à la problématique de l’épuisement professionnel dans les structures spécialisées.
Lire le Rapport complet d’orientation
et les Recommandations de la commission d’audition
Les vidéos, les rapports et les diaporamas des experts
En quoi et jusqu’où la RdRD est-elle un nouveau paradigme dans le champ des conduites addictives ?
Quelles définitions des conduites addictives, des risques et de la RdRD ? Quels en sont les principes fondateurs et les objectifs aujourd’hui ?
En quoi la RdRD est-elle un nouveau paradigme ? La place originelle déterminante des usagers est-elle antinomique de son institutionnalisation ?
Quel périmètre et quelles limites doit avoir la RdRD (vision internationale) ? Doit-elle porter sur la demande (les usages) ou intervenir aussi sur l’offre (l’accès aux produits et leur qualité) ?
Quels sont les différents modèles de RdRD ? Quelle place la RdRD doit-elle avoir dans l’ensemble des interventions et dans la politique des drogues et des addictions en France ?
- Marie Jauffret-Roustide
 texte
texte
Quelles sont les données probantes sur l’efficacité de la RdRD ?
Quelles connaissances avons-nous sur l’efficience/l’efficacité des politiques de RdRD qui se sont développées à l’étranger et en France depuis une trentaine d’années ?
La RdRD est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière de drogues illicites ?
La RdRD est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière d’alcool ?
La RdRD est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière de tabac ?
La RdRD est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière d’addiction sans produit ?
La RdRD est-elle efficace et quelles en sont les limites en matière d’addiction aux médicaments psychotropes et de polyconsommations ?
- Maurice Demattéis
 texte
texte
Comment organiser/soutenir des recherches et des évaluations multidisciplinaires dans le domaine de la RdRD qui aident le développement des pratiques et qui tiennent compte de ce qui est déjà étudié à l’étranger ?
La RdRD nécessite-t-elle de nouvelles pratiques et de nouveaux outils ?
En quoi les pratiques de RdRD peuvent-elles s’intégrer dans les stratégies de prévention et de soin et les améliorer, dans tous les secteurs des addictions ? Quelle place des usagers dans ces modalités d’action ?
Faut-il distinguer des lieux et des acteurs en fonction des modalités d’action (qui fait quoi en matière de RdRD) ? Comment faire de la réduction des risques dans les lieux de traitement ? En centres résidentiels de soins ? En hébergement social ? En prison ?
Comment prendre en compte les phénomènes émergents (nouveaux produits de synthèse, nouveaux publics…) et trouver des réponses adaptées ? Comment permettre au dispositif de RdRD de s’actualiser/s’adapter en permanence en fonction de l’évolution des usages et des problèmes liés aux usages ?
Comment intégrer, dans les pratiques, l’accompagnement et les outils de la consommation à moindre risque ?
Quels outils de RdRD sont adaptés pour intervenir précocement, dès les premiers usages, auprès des jeunes usagers, en particulier les mineurs ?
Quelles sont les conditions nécessaires au développement de la RdRD ?
En quoi l’évolution de la société moderne influe-t-elle sur les phénomènes d’addictions et leurs traitements ?
Comment permettre aux usagers et à leurs associations de jouer un rôle moteur dans la définition et l’application des stratégies de RdRD ?
Comment organiser le dispositif de prévention, de RdR et de soins, pour qu’il intègre la RdRD et propose des espaces différenciés mais sans les cloisonner ?
En quoi le cadre légal et réglementaire actuel est ou n’est pas un obstacle à la RdRD ? Quelles en seraient les évolutions souhaitables pour favoriser la RdRD ?
Comment modifier les représentations de l’opinion publique et valoriser l’intérêt général de développer la RdRD ?
Rapport du Groupe bibliographique
Présentation de l’audition publique 2.0
Les pratiques professionnelles en matière de prévention et de soins dans le champ des conduites addictives connaissent de profonds changements depuis une dizaine d’années. Un « changement de paradigme » lié essentiellement au développement et à l’intégration de la Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) qui vise en priorité à prévenir et à diminuer les conséquences négatives, sanitaires et sociales des conduites addictives. Au-delà des méthodes, ce sont les fondements et les objectifs de l’intervention socio-sanitaire, jusque-là centrés sur l’abstinence, qui sont interrogés.
L’importance des questions que soulève cette évolution, ses retentissements sur les pratiques, les politiques de santé et les articulations avec les autres champs (formation, éducation, justice, etc.), ses enjeux de cohérence et d’appropriation par l’opinion publique ont conduit la Fédération Française d’Addictologie à juger particulièrement nécessaire la tenue d’une Audition Publique sur ce thème.
Selon la méthodologie proposée par la Haute Autorité de Santé qui accompagne son organisation, cette Audition Publique s’est déroulée les 7 et 8 avril 2016 au Ministère de la Santé à Paris, au cours de laquelle sont intervenus une trentaine d’experts chargés de présenter publiquement leurs réponses à des questions définies par le Comité d’Organisation. Une Commission d’Audition de composition large et diversifiée a été chargée d’en tirer des conclusions et des recommandations.
Télécharger le Livret de l’Audition Publique 2.0 RdRD
(programme et rapports des Experts et du Groupe bibliographique).
Commentaires (1)
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.


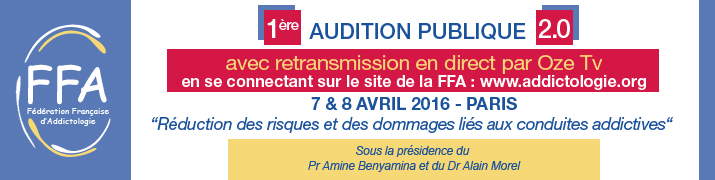
Salut,
Les liens vers les rapport et diaporama des présentations sont morts. Les bons se trouvent sur la page suivante de la FFA : https://www.addictologie.org/action/2016/
A+
Fabrice